*
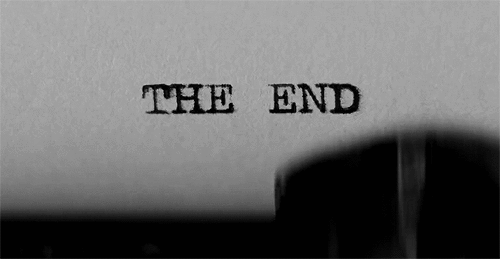

jeudi 19 février 2015
The text of O solitude was drawn by Purcell from three verses of Katherine Philips’s skilful translation of ‘La solitude’ by Antoine Girard de Saint-Amant (1594–1661).
O solitude, my sweetest choice:
Places devoted to the night, Remote from tumult and from noise, How ye my restless thoughts delight! O solitude, my sweetest choice. O heav'ns, what content is mine To see these trees, which have appear'd From the nativity of time, And which all ages have rever'd, To look today as fresh and green As when their beauties first were seen. O, how agreeable a sight These hanging mountains do appear, Which th' unhappy would invite To finish all their sorrows here, When their hard fate makes them endure Such woes as only death can cure.
O, how I solitude adore!
That element of noblest wit, Where I have learnt Apollo's lore, Without the pains to study it. For thy sake I in love am grown With what thy fancy does pursue; But when I think upon my own, I hate it for that reason too, Because it needs must hinder me From seeing and from serving thee. O solitude, O how I solitude adore!
O que j’ayme la solitude !
Que ces lieux sacrez à la nuit, Esloignez du monde et du bruit, Plaisent à mon inquietude ! Mon Dieu ! que mes yeux sont contens De voir ces bois, qui se trouverent A la nativité du temps, Et que tous les siècles reverent, Estre encore aussi beaux et vers, Qu’aux premiers jours de l’univers !
Que je prens de plaisir à voir
Ces monts pendans en precipices, Qui, pour les coups du desespoir, Sont aux malheureux si propices, Quand la cruauté de leur sort, Les force a rechercher la mort !
O que j’ayme la solitude !
C’est l’element des bons esprits, C’est par elle que j’ay compris L’art d’Apollon sans nulle estude. Je l’ayme pour l’amour de toy, Connaissant que ton humeur l’ayme Mais quand je pense bien à moy, Je la hay pour la raison mesme Car elle pourroit me ravir L’heur de te voir et te servir.
O que j’ayme la solitude !
Que ces lieux sacrez à la nuit, Esloignez du monde et du bruit, Plaisent à mon inquietude ! Mon Dieu ! que mes yeux sont contens De voir ces bois, qui se trouverent A la nativité du temps, Et que tous les siècles reverent, Estre encore aussi beaux et vers, Qu’aux premiers jours de l’univers ! Un gay zephire les caresse D’un mouvement doux et flatteur. Rien que leur extresme hauteur Ne fait remarquer leur vieillesse. Jadis Pan et ses demi-dieux Y vinrent chercher du refuge, Quand Jupiter ouvrit les cieux Pour nous envoyer le deluge, Et, se sauvans sur leurs rameaux, A peine virent-ils les eaux. Que sur cette espine fleurie Dont le printemps est amoureux, Philomele, au chant langoureux, Entretient bien ma resverie ! Que je prens de plaisir à voir Ces monts pendans en precipices, Qui, pour les coups du desespoir, Sont aux malheureux si propices, Quand la cruauté de leur sort, Les force a rechercher la mort ! Que je trouve doux le ravage De ces fiers torrens vagabonds, Qui se precipitent par bonds Dans ce valon vert et sauvage ! Puis, glissant sour les arbrisseaux, Ainsi que des serpens sur l’herbe, Se changent en plaisans ruisseaux, Où quelque Naïade superbe Regne comme en son lict natal, Dessus un throsne de christal ! Que j’ayme ce marets paisible ! Il est tout bordé d’aliziers, D’aulnes, de saules et d’oziers, À qui le fer n’est point nuisible. Les nymphes, y cherchans le frais, S’y viennent fournir de quenouilles, De pipeaux, de joncs et de glais ; Où l’on voit sauter les grenouilles, Qui de frayeur s’y vont cacher Si tost qu’on veut s’en approcher. Là, cent mille oyseaux aquatiques Vivent, sand craindre, en leur repos, Le giboyeur fin et dispos, Avec ses mortelles pratiques. L’un tout joyeux d’un si beau jour, S’amuse à becqueter sa plume ; L’autre allentit le feu d’amour Qui dans l’eau mesme se consume, Et prennent tous innocemment Leur plaisir en cet élement. Jamais l’esté ny la froidure N’ont veu passer dessus cette eau Nulle charrette ny batteau, Depuis que l’un et l’autre dure ; Jamais voyageur alteré N’y fit servir sa main de tasse ; Jamais chevreuil desesperé N’y finit sa vie à la chasse ; Et jamais le traistre hameçon N’en fit sortir aucun poisson. Que j’ayme à voir la décadence De ces vieux chasteaux ruinez, Contre qui les ans mutinez Ont deployé leur insolence ! Les sorciers y font leur savat ; Les demons follets y retirent, Qui d’un malicieux ébat Trompent nos sens et nous martirent ; Là se nichent en mille troux Les couleuvres et les hyboux. L’orfraye, avec ses cris funebres, Mortels augures des destins, Fait rire et dancer les lutins Dans ces lieux remplis de tenebres. Sous un chevron de bois maudit Y branle le squelette horrible D’un pauvre amant qui se pendit Pour une bergère insensible, Qui d’un seul regard de pitié Ne daigna voir son amitié. Aussi le Ciel, juge équitable, Qui maintient les loix en vigueur, Prononça contre sa rigueur Une sentence epouvantable : Autour de ces vieux ossemens Son ombre, aux peines condamnée, Lamente en longs gemissemens Sa malheureuse destinée, Ayant, pour croistre son effroy, Tousjours son crime devant soy. Là se trouvent sur quelques marbres Des devises du temps passé ; Icy l’âge a presque effacé Des chiffres taillex sur les arbres ; Le plancher du lieu le plus haut Est tombé jusques dans la cave, Que la limace et le crapaud Souillent de venin et de bave ; Le lierre y croist au foyer, A l’ombrage d’un grand noyer. Là dessous s’estend une voûte Si sombre en un certain endroit, Que, quand Phebus y descendroit, Je pense qu’il n’y verrroit goutte ; Le Sommeil aux pesans sourcis, Enchanté d’un morne silence, Y dort, bien loing de tous soucis, Dans les bras de la Nonchalence, Laschement couché sur le dos Dessus des gerbes de pavots. Au creux de cette grotte fresche, Où l’Amour se pourroit geler, Echo ne cesse de brusler Pour son amant froid et revesche, Je m’y coule sans faire bruit, Et par la celeste harmonie D’un doux lut, aux charmes instruit, Je flatte sa triste manie Faisant repeter mes accords A la voix qui luy sert de corps. Tantost, sortant de ces ruines, Je monte au haut de ce rocher, Dont le sommet semble chercher En quel lieu se font les bruïnes ; Puis je descends tout à loisir, Sous une falaise escarpée, D’où je regarde avec plaisir L’onde qui l’a presque sappée Jusqu’au siege de Palemon, Fait d’esponges et de limon. Que c’est une chose agreable D’estre sur le bord de la mer, Quand elle vient à se calmer Après quelque orage effroyable ! Et que les chevelus Tritons, Hauts, sur les vagues secouées, Frapent les airs d’estranges tons Avec leurs trompes enrouées, Dont l’eclat rend respectueux Les vents les plus impetueux. Tantost l’onde brouillant l’arène, Murmure et fremit de courroux Se roullant dessus les cailloux Qu’elle apporte et qu’elle r’entraine. Tantost, elle estale en ses bords, Que l’ire de Neptune outrage, Des gens noyex, des monstres morts, Des vaisseaux brisez du naufrage, Des diamans, de l’ambre gris, Et mille autres choses de prix. Tantost, la plus claire du monde, Elle semble un miroir flottant, Et nous represente à l’instant Encore d’autres cieux sous l’onde. Le soleil s’y fait si bien voir, Y contemplant son beau visage, Qu’on est quelque temps à savoir Si c’est luy-mesme, ou son image, Et d’abord il semble à nos yeux Qu’il s’est laissé tomber des cieux. Bernières, pour qui je me vante De ne rien faire que de beau, Reçoy ce fantasque tableau Fait d’une peinture vivante, Je ne cherche che les deserts, Où, resvant tout seul, je m’amuse A des discours assez diserts De mon genie avec la muse ; Mais mon plus aymable entretien C’est le ressouvenir du tien. Tu vois dans cette poesie Pleine de licence et d’ardeur Les beaux rayons de la splendeur Qui m’esclaire la fantaisie : Tantost chagrin, tantost joyeux Selon que la fureur m’enflame, Et que l’objet s’offre à mes yeux, Les propos me naissent en l’ame, Sans contraindre la liberté Du demon qui m’a transporté. O que j’ayme la solitude ! C’est l’element des bons esprits, C’est par elle que j’ay compris L’art d’Apollon sans nulle estude. Je l’ayme pour l’amour de toy, Connaissant que ton humeur l’ayme Mais quand je pense bien à moy, Je la hay pour la raison mesme Car elle pourroit me ravir L’heur de te voir et te servir. |
lundi 16 février 2015
Pline le Jeune-Lettres, Livre II, Lettre II
[2,2]
C- PLINIUS PAULINO SUO S-.
(1) Irascor,
nec liquet mihi an debeam, sed irascor. Scis,
quam sit amor iniquus interdum, impotens saepe, 'mikraitios' semper. Haec tamen
causa magna est, nescio an iusta; sed ego, tamquam non minus iusta quam magna
sit, grauiter irascor, quod a te tam diu litterae nullae. (2) Exorare me potes
uno modo, si nunc saltem plurimas et longissimas miseris. Haec mihi sola
excusatio uera, ceterae falsae uidebuntur. Non sum auditurus 'non eram Romae'
uel 'occupatior eram'; illud enim nec di sinant, ut 'infirmior'. Ipse ad uillam
partim studiis partim desidia fruor, quorum utrumque ex otio nascitur. Vale.
Je
suis en colère, sans savoir si c’est à tort ou à raison, mais je suis en
colère. Tu n’ignores point combien l’amour peut être tumultueux parfois, emporté
souvent, querelleur toujours. Je ne sais pas si mon courroux est justifié, mais
il est immense sans aucun doute. Et quand il serait plus juste que puissant, je
n’en serais pas moins extrêmement en colère, car depuis si longtemps je n’ai
plus de lettres de toi. Le seul moyen d’obtenir ma clémence, serait à tout le
moins de m’envoyer sur le champ plusieurs courriers et bien fournis encore. Ce
serait à mes yeux la seule repentance sincère, et aucune autre ne serait valable.
Je te préviens que je ne suis pas d’humeur à souffrir des « je n’étais
point dans Rome », des « j’étais occupé », encore moins des
« j’étais souffrant ». Quant à moi, dans ma campagne, je partage mon
temps entre les plaisirs de l’étude et ceux de la paresse, tous fruits du doux
loisir. Adieu.
dimanche 15 février 2015
Pline le Jeune- Lettres, Livre I, Lettre 15
[1,15]
C- PLINIUS SEPTICIO CLARO SUO S-
(1) Heus tu!
Promittis ad cenam, nec uenis? Dicitur
ius: ad assem impendium reddes, nec id modicum. (2) Paratae erant lactucae
singulae, cochleae ternae, oua bina, halica cum mulso et niue - nam hanc quoque
computabis, immo hanc in primis quae perit in ferculo -, oliuae betacei
cucurbitae bulbi, alia mille non minus lauta. Audisses comoedos uel lectorem uel lyristen uel - quae mea
liberalitas - omnes. (3) At tu apud nescio quem ostrea uuluas echinos Gaditanas
maluisti. Dabis poenas, non dico quas. Dure fecisti: inuidisti, nescio an tibi,
certe mihi, sed tamen et tibi. Quantum nos lusissemus risissemus studuissemus!
(4) Potes apparatius cenare apud multos, nusquam hilarius simplicius incautius.
In summa experire, et nisi postea te aliis potius excusaueris, mihi semper
excusa. Vale.
Dis-donc,
toi ! je t’invite à ma table, et tu ne viens pas ? Pour la peine, je
te condamne à en supporter toute la dépense, et je te garantis qu’elle n’est
pas des moindres. J’avais fait préparer en effet pour chaque convive une laitue,
trois escargots, deux œufs, de la semoule avec du miel et de la neige – n’oublie
pas de compter la neige, et compte-la plutôt en premier, car elle a fondu avant
tout le reste-, des olives, des betteraves, des concombres, des oignons, et mille
autres mets encore et non moins raffinés. Tu aurais pu entendre des comédiens dire un poème, ou chanter un air, voire, car
telle est ma munificence, et l’un et l’autre. Mais tu as préféré, chez je ne sais qui, des huîtres, de la vulve
de truie, des oursins et des danseuses nues de Gadès. Tu en subiras les
conséquences, je ne t’en dirai pas plus. Tu as agis grossièrement : tu as
été malveillant, envers toi-même je ne sais pas, mais envers moi à coup sûr, et oui pour tout dire surtout
avec toi-même. Combien nous aurions plaisanté, ri et disserté ensemble !
Tu trouveras j’en suis sûr, et sans difficultés, bien des tables mieux achalandées ;
tu n’en trouveras pas de plus gaies, de plus simples et de plus accueillantes. Essaie-je
te prie, et s’il s’avère au final que tu ne préfères pas t’excuser partout
ailleurs, alors excuse-toi chez moi pour toujours. Adieu.
vendredi 13 février 2015
Inscription à :
Articles (Atom)












