| L'art de cuisiner des kakis |
| QUAND ON APPREND UNE LANGUE sans passer par la sienne, il peut arriver que l'on ait affaire à des mots dont on perçoit profondément le sens sans parvenir à les traduire. C'était mon cas, en japonais, avec l'adjectif shibui. Partant du principe que la langue nipponne ne cesse de gagner du terrain en français - sushi, kamikaze, tsunami, pour ne citer qu'eux, sont dans nos dictionnaires depuis des années -, je l'employais tel quel en français, anticipant sa victoire. Lorsqu'on me demandait ce que cela voulait dire, je répondais : " Quelque chose comme âpre. " Je viens de lire un petit essai de Ryoko Sekiguchi consacré précisément à cet adjectif et qui s'intitule L'Astringent. Dans un premier temps, cette découverte m'a remplie d'âpreté : comment n'avais-je pas pensé à l'astringence pour traduire ce concept ? Mais très vite, le charme de cette lecture a effacé mon amertume. D'autant que le propos de l'auteur rejoint le mien : même si c'est bel et bien d'astringence qu'il est question, l'adjectif shibui est infiniment plus complexe. S'appliquant aux aliments, son sens est désormais élucidé. S'appliquant à l'esthétique, le terme résiste à une traduction aussi simple. Un vase peut être qualifié de shibui quand son aspect a quelque chose de rugueux. Une étoffe est shibui quand sa couleur est subtile, aux antipodes du tape-à-l'oeil. Un homme (mais pas une femme) a le droit d'être dit shibui s'il vieillit avec élégance, si le temps lui donne une patine pleine de classe. On l'a compris : l'esthétique shibui correspond, pour les Japonais, au comble du bon goût. Si vous visitez une exposition avec un ami nippon et que vous tombez en pâmoison devant une oeuvre à peine visible, peut-être vous adoubera-t-il de ce suprême compliment : " Vous avez le goût shibui. " Autrement dit, vous n'aimez pas ce qui est clinquant. Comble du raffinement Je m'étais toujours demandé ce qui avait permis le glissement de sens d'une saveur perçue comme désagréable à un goût tenu pour le plus aristocratique. Ryoko Sekiguchi y apporte une explication convaincante. L'aliment astringent le plus fréquent au Japon est le kaki, sorte de roulette russe fruitière : on ne sait jamais, quand on mord dans un kaki, si on va tomber sur cette suavité merveilleuse ou sur cette horrible astringence - cette dernière expérience, aussi cruelle que fréquente, est vue par les Nippons comme un puissant antidote contre la bêtise. Les Japonais ont pris l'habitude de recycler les kakis immangeables pour cause d'astringence en une teinture d'une couleur un peu fade et indéfinissable, brunâtre et proche de la nature. Là où l'Occidental aurait bêtement vu un coloris médiocre, le Nippon a décidé de voir le comble du raffinement - et l'a prouvé, en créant une esthétique que nous portons désormais tous aux nues. C'est aussi pour cela que le Japon me fascine tant : aucun pays ne met à ce point en échec l'hypothèse des universaux. Et même cela, il le fait de façon élégante, sans l'effet " pavé dans la mare " que le reste du monde recherche. Le petit livre de Ryoko Sekiguchi est une véritable bombe anti-scolastique, déguisée en une douce méditation sur l'art de cuisiner les kakis. Ryoko Sekiguchi écrit en français avec une délicatesse dont je vous laisse juge : " Les douceurs peuvent nous procurer de la joie et du réconfort, le salé nous communiquer l'énergie vitale, mais face à l'énigme de la vie, le sucré ni l'acide ne fournissent de réponse. Au demeurant, il n'est pas de réponse qui fasse pendant à l'énigme. Le fait est bien connu : on ne saurait répondre à l'énigme que par une autre énigme. Et c'est bien là, je crois, le sens des goûts périphériques, seuls capables de nous accompagner dans notre parcours à la manière d'une nouvelle énigme. " Amélie Nothomb, écrivain |
*
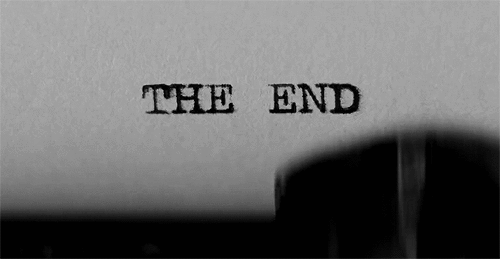

vendredi 27 avril 2012
LM 27 AVRIL 2012
jeudi 26 avril 2012
LM 27 AVRIL 2012
| L'ère du cerveau |
| On s'en raconte, des histoires de cerveau ! Des simplettes, des subtiles, des retorses. D'autres fascinantes ou bien effroyables, à moins que ce ne soit les deux, selon la perspective. Des futuristes, surtout. Mais toujours des histoires. Parce que le cerveau est devenu, au fil des décennies, comme une nouvelle frontière. Continent à cartographier, à comprendre, demain peut-être à maîtriser, voire à transformer en profondeur. Si l'on admet que le secret de ce qui fait l'humain y réside, pareille métamorphose signerait l'avènement d'une nouvelle espèce, avec ce qui s'ensuivrait de sociétés et d'événements inédits. Bien que le conditionnel s'impose, envisager ces éventualités semble devenu inévitable. La science, désormais, ne peut écarter les scénarios surprenants. C'est ce que confirme le nouveau livre de deux grands scientifiques qui connaissent, si l'on peut dire, le cerveau par coeur. Jean-Didier Vincent, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, auteur notamment de Voyage extraordinaire au centre du cerveau (Odile Jacob, 2007), et Pierre-Marie Lledo, un des chercheurs de pointe en neurobiologie, qui travaille à l'Institut Pasteur et au CNRS, proposent avec Le Cerveau sur mesure une claire mise en perspective des connaissances actuelles et une exploration de ce que l'avenir peut réserver. Ils insistent en particulier sur la plasticité du cerveau humain, que l'on considère aujourd'hui comme reconfigurable, capable d'une infinité de câblages singuliers selon les individus, leurs expériences et leur environnement. La découverte d'un renouvellement des neurones, en particulier dans le système de l'odorat, ouvre d'autre part des perspectives inédites aux thérapeutiques futures des dégénérescences cérébrales. Les progrès de la chimie font entrevoir une nouvelle génération de psychostimulants, et les possibilités d'augmenter notre mémoire, de perfectionner la vision nocturne ou de multiplier les interfaces homme-machine ne semblent presque plus appartenir à la science-fiction. A moins qu'il ne faille admettre que science et fiction ont partie liée. C'est ce que suggère Pierre Cassou-Noguès dans Lire le cerveau, une originale fiction philosophique où s'entrelacent expériences de pensée, analyses conceptuelles et récit romanesque. Son thème : l'avenir des " B.R. ", non pas les Brigades rouges mais les brain readers, " lecteurs de cerveau ", des machines censées lire les intentions, souvenirs et sentiments directement à l'intérieur de nos crânes. Tout laisse penser que ces mécaniques nous pendent aux neurones. Le philosophe ne fait que développer une logique animant déjà l'époque. Au bout de la recherche, il imagine joliment ce qu'il adviendra de Marcel et d'Albertine quand Proust disposera, enfin, des moyens de lire effectivement tout ce que la belle a en tête. Fondée sur tout ce que l'imagerie cérébrale permet déjà de détecter de nos processus mentaux, la réflexion-fiction de Pierre Cassou-Noguès en extrapole allègrement les développements à venir au cours des prochaines décennies. D'abord perfectionné sous le contrôle du FBI, le brain reader devrait permettre, dans ses versions de départ, de détecter les intentions hostiles de terroristes clandestins. De progrès en progrès, il finirait par rendre silencieux tous les lieux publics : deux petites électrodes suffiront alors à chacun pour lire les pensées des autres. Les derniers " parleurs " qui résisteront encore feront figure d'espèce en voie de disparition. Qu'on ne s'y trompe pas : ce philosophe ne largue pas l'analyse des concepts pour laisser libre cours au jeu de l'imagination. Car la " folle du logis ", comme dit Malebranche, marche ici du même pas que l'interrogation philosophique. La conviction centrale de Pierre Cassou-Noguès est en effet que " la fiction détermine le possible " : elle donne à la recherche son matériau et son cadre. Dans cette perspective, le récit lui-même constitue une expérience de pensée : s'il existait des lecteurs de cerveau, qu'est-ce qui changerait de l'amour, du droit, des relations sociales ? Et de la représentation de notre intériorité ? Que se passerait-il si cette intériorité devenait visible à tous, étalée au dehors, en images et en mots ? En fin de compte, les histoires qu'on se raconte à propos du cerveau ne seraient jamais fantasmagories totalement vaines. Elles ont peu de chances de se concrétiser, les connaissances scientifiques et les capacités techniques demeurent aujourd'hui très en deçà de leur horizon. Mais elles ouvrent à la pensée des possibilités immédiates, permettent à notre cerveau de se reconfigurer, de s'inventer de nouvelles aventures, d'envisager des hypothèses inédites sur le monde et sur lui-même. C'est ce qu'il fait de mieux, somme toute. Et depuis bien longtemps... . Roger-Pol Droit |
LM 27 AVRIL 2012
| " Les monstres ont triomphé des dieux " |
| Historien de l'art, ancien directeur du Musée Picasso et académicien, Jean Clair propose, dans son nouvel essai, une réflexion sur le monstrueux dans l'art moderne et contemporain. Vous constatez un retour des monstres dans l'art, mais le monstre est une figure classique et récurrente dans l'art depuis les Grecs (cyclopes, satyres...) : qu'y a-t-il de nouveau ? Bien sûr, les monstres existent dans la Grèce classique, effrayants, terrifiants ; ils sont là pour détruire l'harmonie - " la tranquille simplicité et la calme grandeur ", disait l'historien d'art allemand J. J. Winckelmann - d'un univers essentiellement régi par les dieux, qui sont des créations idéalisées de l'homme : Apollon, Aphrodite et d'autres. C'est à l'intérieur de cet univers de lumière et de beauté qu'apparaissent des monstres, qui sont eux-mêmes extrêmement normés, comme la Gorgone, ou des géants comme les Lestrygons qui vont essayer de dévorer Ulysse et ses compagnons. Ce qui est étonnant dans l'art moderne et contemporain, c'est que les monstres, les nouveaux Titans, semblent avoir triomphé des dieux, et que la laideur semble avoir pris le pas sur la beauté comme élément d'attraction et de fascination. Comment est-on passé d'un monde d'harmonie, de calme, de beauté, celui qui prévaut depuis Phidias jusqu'à David, à un monde, celui de l'art moderne et contemporain, où prévalent des catégories comme le difforme, le monstrueux, l'horrible, l'effrayant, le stupéfiant ? La catégorie de l'étonnant remplace la catégorie de l'admirable. D'où cela vient-il ? Pour répondre, il faut éviter, d'un côté, le piège de la déploration nostalgique et, de l'autre, la tentation de la récrimination réactionnaire dans la mesure où, en art, l'appel à une restauration des lois antiques de la beauté est toujours venue de régimes autoritaires, voire dictatoriaux - nazisme et stalinisme se réclament par exemple d'une esthétique fondée sur la beauté classique. Comment en est-on arrivé là ? Il faudrait rappeler la phrase de Marx parlant de la Grèce antique : " Jamais oeuvres d'une telle beauté ne se sont vues ni ne se verront " ; au fond, pour Marx, la beauté antique est une beauté indépassable. Ou se souvenir encore que Freud trouvait inquiétante la prolifération des formes monstrueuses et trouvait repoussante, par exemple, la vision des organes génitaux ! Selon lui, la beauté était une narcose légère... Ainsi deux des grands prophètes de notre modernité, Marx et Freud, sont-ils passés à côté de l'art moderne... Pourquoi aller voir du côté de l'histoire des sciences ? C'est aller à contre-courant d'une certaine paresse française ou d'un certain confort qui est d'enseigner l'histoire de l'art comme un modèle refermé sur lui-même. Au contraire, formé selon Aby Warburg (historien de l'art allemand, 1866-1929), durant mes études aux Etats-Unis, j'ai toujours pensé que l'art moderne et contemporain tirait ses modèles du monde extérieur, et en particulier, du développement de l'histoire des sciences. Pourtant, même à l'intérieur de cette tradition de l'histoire de l'art comme reflet de l'histoire des idées, même, selon un génie comme Erwin Panofsky (1892-1968), l'inventeur de l'iconologie, qui analyse les images comme symptômes culturels, sa discipline s'achèverait au début du XXe siècle par la disparition des modèles qui avaient formé l'iconographie (le répertoire des thèmes) des siècles précédents. Je ne le crois pas. Pour revenir aux monstres, on constate qu'un énorme précipice s'ouvre à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : on ne peut plus représenter un corps comme on le représentait autrefois. Pourquoi ? Je cite un certain nombre de faits et de découvertes scientifiques, qui sont tous, à peu près, situés la même année 1895 (celle, par ailleurs, de la première Biennale de Venise) : les rayons X, la photographie, la téléphonie, mais également les premières théories neurologiques sur la façon dont le corps fonctionne, les premières études sur l'hystérie... Toutes ces nouveautés radicales, bouleversantes, laissent l'artiste complètement démuni ; il ne peut plus continuer à s'appuyer sur un corpus esthétique. Pourquoi ce tournant du siècle est-il décisif ? Pour donner un exemple très précis, vous avez d'un côté un neurologue, Paul Richet, qui était en même temps professeur à l'Ecole supérieure des beaux-arts de Paris, et qui, en 1906, publie sa Nouvelle anatomie artistique du corps humain. C'est un manuel à l'usage des étudiants en histoire de l'art qu'il écrit à partir de sa science de médecin. En fait, cette anatomie, qui se prétend nouvelle, est une répétition des anciennes anatomies classiques, sauf qu'elle est rendue plus attirante par l'éloge de l'athlétisme et du corps musclé, " body-buildé ". Le manuel tombera à plat... sauf dans l'Allemagne nationale-socialiste et dans la Russie soviétique ! Il servira à fabriquer les grandes machines exhibant des athlètes faits à l'image des dieux grecs. Ainsi, le modèle accompli de Paul Richet sera Arno Breker, le sculpteur d'Hitler. En revanche, on remarque, en 1907, trois autres événements qui sont loin de l'univers de Richet : c'est la parution, d'abord, de l'ouvrage d'un aliéniste, Marcel Réja : L'Art chez les fous, la première compilation sur l'art psychopathologique, fabriqué par des aliénés mentaux. C'est aussi pendant cette année 1907 qu'Aloïs Alzheimer découvre la maladie qui va porter son nom et que Picasso peint l'un de ses tableaux les plus célèbres Les Demoiselles d'Avignon : c'est peut-être un chef-d'oeuvre, mais c'est l'apparition éclatante de la laideur et de personnages à la morphologie monstrueuse. A partir de là apparaît un écart absolu entre la prolongation de l'esthétique classique sous des formes qui ne fonctionnent plus et l'apparition de nouvelles données bouleversantes qui aboutissent à des anatomies bouleversées. La science et l'art partagent-ils la même curiosité pour le monstrueux ? Quand l'artiste veut continuer à représenter des visages ou des corps, il n'a plus aucune règle précise à sa disposition, rien qui puisse s'enseigner, il est livré à sa subjectivité totale. Donc on aboutit à une prolifération de monstres sans aucune unité, qui sont chaque fois la production singulière d'un individu nommé artiste. Quand je parle de monstre, ce n'est pas dans le sens dépréciatif : le tableau de Max Ernst L'Ange du foyer (1937) est un chef-d'oeuvre mais c'est aussi et d'abord un monstre. Pour le savant dans son laboratoire, le monstre est l'occasion d'étudier la normalité du développement, il cesse d'être un objet particulier pour devenir un sujet commun d'expérience. La science s'intéresse au monstrueux pour expliquer la normalité. L'art, à l'inverse, décompose sa propre tradition pour tirer ses formes de sa dislocation et revendique la liberté de créer un objet autonome, indépendant, autojustifié, un monstre... Les deux disciplines se séparent totalement alors que, jusque-là, elles étaient unies puisque, je le rappelle, l'anatomie s'enseignait dans les théâtres d'anatomie indifféremment pour les médecins et pour les artistes. C'était la même connaissance du corps qui passait soit dans la peinture soit dans la clinique. La disparition du beau témoignerait d'une forme d'hubris ? L'hubris, c'est la démesure, c'est ce qui excède la norme, la rigueur, la règle, la loi. Et cet excès dans les formes ou dans les moeurs est puni par la Némésis, la déesse de la vengeance. Aujourd'hui la nouvelle règle, c'est le monstrueux, l'excès, jusqu'aux formes extraordinaires que prennent certaines manifestations qui tombent dans la coprophilie ou quasiment dans le meurtre chez certains artistes d'avant-garde. Est-ce que ce sont les symptômes d'une société en décadence ? Je n'irai pas jusque-là, dans la mesure où il y a, en dehors de la peinture et de la sculpture, beaucoup d'autres formes d'art aujourd'hui qui nous assurent une satisfaction esthétique, morale : le cinéma, par exemple, la danse... Peut-être la peinture est-elle morte ? Je n'en sais rien, elle n'a pas toujours existé après tout... Est-ce que le monstrueux gagnerait aussi la littérature ? Je ne le crois pas. Ce qui caractérise notre époque, c'est au contraire une rupture entre le monde littéraire et le monde artistique. A toutes les époques de la modernité, vous trouvez des compagnonnages et des amitiés qui font qu'écrivains et artistes se retrouvent dans les mêmes lieux et discutent des mêmes choses ; c'est vrai du romantisme, du symbolisme, du cubisme... On n'imagine pas le surréalisme sans l'amitié de Breton, Eluard, Picasso, Dali, Marx Ernst. Aujourd'hui, je ne vois plus tellement cette osmose délicate. Peut-être parce que le monde artistique est tellement éloigné de la réalité qu'il ne peut rencontrer ni la compréhension ni l'intérêt de gens dont la pratique créatrice reste quand même liée au respect de certaines règles : vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi ; vous êtes obligé d'user d'un langage commun, compris par tous. On peut trouver des artistes qui sont eux-mêmes très proches des écrivains, Pierre Alechinsky, qui écrit merveilleusement bien ou, inversement, quelqu'un comme Yves Bonnefoy, le poète, proche de certains peintres, mais ce sont des cas très isolés. Et si j'ose dire, chacun va mourir de son côté. Julie Clarini |
mercredi 25 avril 2012
Retraite
La retraite à 65 ans, instaurée en 1885 pour les fonctionnaires allemands, n'a pas été créée pour être longue (l'espérance de vie des hommes était alors de 35 ans, celle des femmes de 38 ans). Une correspondance prouve que Bismarck, alors chancelier, a demandé à un statisticien : " A quel âge peut-on fixer la retraite de telle façon que nous n'ayons rien à payer ? ".
mercredi 18 avril 2012
lundi 16 avril 2012
LM 14 AVRIL 2012
| La " culture gé " à l'épreuve |
| Des grandes écoles, dont Sciences Po, suppriment de leur examen d'entrée la dissertation de culture générale. Une décision funeste ou salutaire ? |
| Lorsqu'on évoque le spectre de la disparition de la " culture générale ", Françoise Melonio soupire. Depuis quelques mois, cette professeure de littérature à la Sorbonne, qui a publié une histoire culturelle de la France aux XVIIIe et XIXe siècles, passe aux yeux des puristes pour une fossoyeuse de la culture générale : elle est la doyenne du collège universitaire de Sciences Po, qui vient de supprimer cette épreuve de l'examen d'entrée. Ulcérés, des intellectuels ont dénoncé un acte " suicidaire " qui " coupe nos enfants des meilleures sources du passé ". " En bannissant des écoles, petites ou grandes, les noms mêmes de Voltaire et de Stendhal, d'Aristote et de Cicéron, ces "visionnaires" ne seraient-ils pas en train de compromettre notre avenir ? ", demandent Régis Debray, Marc Fumaroli, Michel Onfray, Jean d'Ormesson, Erik Orsenna et Philippe Sollers. Cette croisade menée au nom des humanités classiques laisse Françoise Melonio perplexe : avec cette réforme, Sciences Po estime au contraire avoir recentré l'examen d'entrée sur les fondamentaux. La dissertation d'histoire a été maintenue et les candidats devront passer un oral de langue ainsi qu'une épreuve écrite de mathématiques, de sciences économiques et sociales ou de littérature-philosophie - le commentaire d'un texte de Stendhal ou de Gracq l'année dernière, de Proust ou Chateaubriand la précédente. " La littérature ne fait-elle pas partie de la culture générale ? ", sourit Françoise Melonio. Ces épreuves ont été complétées par un oral portant sur les goûts intellectuels des candidats et par l'examen de leur dossier scolaire depuis la classe de seconde. " Il permet de vérifier la cohérence de leur parcours et d'atténuer l'effet parfois aléatoire des épreuves écrites ", explique-t-elle. Si la fameuse dissertation d'" ordre général " a été supprimée, c'est après une longue réflexion sur ses effets pervers : cette épreuve encourage, selon Françoise Melonio, une " culture de ouï-dire " un peu creuse. " Elle est adaptée à des étudiants qui ont deux ou trois ans d'études supérieures et beaucoup de lectures derrière eux, explique-t-elle. Mais lorsqu'ils se présentent à Sciences Po, en mars, les candidats ont 17 ou 18 ans, ils sont en terminale et ils ont fait à peine six mois de philosophie. Du coup, ils n'ont pas lu grand-chose et beaucoup de copies ressemblent à des blocs de cours reliés plus ou moins astucieusement les uns aux autres. Nous préférons une culture de première main faite de lectures approfondies à une culture de morceaux choisis ou de name dropping élaborée à partir de fiches. " Si les défenseurs de la " culture générale " se sont mobilisés avec tant de passion contre la réforme de Sciences Po, c'est qu'ils savent que, depuis quelques années, le vent ne leur est guère favorable. L'Ecole normale supérieure de Lyon vient ainsi de remplacer l'oral de " culture générale littéraire et artistique " du concours d'entrée par un exposé portant sur six ouvrages de recherche qui ont marqué les lettres ou les sciences humaines. " L'épreuve de culture générale se résumait souvent à des lieux communs un peu standardisés bachotés en classe préparatoire, affirme le président de l'ENS de Lyon, Jacques Samarut. Le nouvel oral devrait favoriser un travail de fond et une réflexion personnelle sur les oeuvres. L'esprit a changé : il ne s'agit pas de réciter une fiche ou de connaître des citations, mais de présenter une lecture critique d'un texte important. " Au cours des cinq dernières années, la fonction publique a, elle aussi, pris ses distances avec la " culture générale ". Nicolas Sarkozy avait estimé, en 2007, que seuls des sadiques ou des imbéciles avaient pu inscrire La Princesse de Clèves, de Mme de La Fayette, au programme du concours d'attachés d'administration. Un an plus tard, son ministre de la fonction publique, André Santini, dénonçait l'" élitisme stérile " du recrutement des fonctionnaires : " Les épreuves de culture générale ont été dévoyées et elles servent maintenant à coller les candidats. On pose des questions trop académiques et ridiculement difficiles qui n'indiquent rien des réelles aptitudes à remplir un poste. A quoi cela sert-il d'avoir une épreuve d'histoire pour les pompiers ? " A Sciences Po, à l'ENA, dans les grandes écoles de commerce et la plupart des concours administratifs, la " culture gé " a longtemps constitué un rituel incontournable. La plupart des sujets se présentent sous la forme d'une question : " La beauté sauvera-t-elle le monde ? " (Ecole nationale de la magistrature, 2008), " La République peut-elle encore faire confiance au progrès pour rester fidèle à elle-même ? " (ENA, 2004), " L'imagination, est-ce la liberté de pensée ? " (écoles de management, 2011). Les candidats sont priés de rédiger une longue dissertation " à la française " avec une introduction en entonnoir, un plan en deux ou trois parties, une conclusion. Cet exercice rhétorique est extrêmement codifié : les correcteurs admettent sans difficulté que le style compte pour beaucoup, que le plan est essentiel et qu'ils apprécient les références culturelles et les citations de grands hommes. La dissertation de " culture gé " ne concerne pas uniquement les grandes écoles qui forment les élites du pays : en France, la plupart des candidats à la fonction publique doivent se plier à ce rituel. Il y a cinq ans, le concours de secrétaire administratif du ministère de l'intérieur imposait ainsi une dissertation de trois heures sur " un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain " : " Peut-on dire en 2007 que la femme est un homme comme les autres ? " Les intellectuels étrangers regardent cet exercice très français avec une stupéfaction amusée : rares sont ceux qui comprennent qu'un pays sélectionne ses fonctionnaires et ses élites en leur demandant de formuler dans une dissertation de grandes idées générales puisées dans la littérature, la philosophie, l'histoire ou les arts. Beaucoup moquent même ce goût pour l'abstraction qui, selon eux, frôle la cuistrerie. " La dissertation de culture générale est un mode de recrutement propre à la France, constate Dominique Meurs, professeure d'économie à l'université de Nanterre et chercheuse à EconomiX et à l'Institut national d'études démographiques (INED). Les autres pays embauchent généralement leurs fonctionnaires sans concours, à travers des entretiens d'évaluation qui permettent de mesurer, non les connaissances académiques, mais les compétences professionnelles des candidats. " Nos voisins se moquent, mais les défenseurs de la dissertation de " culture gé " n'en ont cure : pour eux, cet exercice permet aux étudiants de développer une réflexion élaborée et documentée. " La France est construite sur une religion : les élites doivent être formées au débat d'idées, explique l'écrivain Xavier Patier, directeur de la Documentation française. La forme joue, il est vrai, un rôle important, mais c'est normal : l'élégance du style est une façon de respecter le lecteur, tout comme les manières, à table, sont marque de respect pour les convives. La dissertation de culture générale repose sur des raisonnements un peu formels, mais elle permet aux étudiants de mobiliser leurs connaissances historiques, littéraires, philosophiques ou artistiques au service d'une vision du monde. C'est un effort qui correspond à notre modèle culturel et qui nous arme face à la mondialisation. " Les responsables des grandes écoles de management estiment, eux aussi, que la culture générale est un bon outil de sélection, ne serait-ce que parce que les entreprises le demandent. " Il s'agit d'un élément incontournable de la formation des cadres, précise Thierry Debay, directeur des admissions et concours des 25 écoles de management réunies dans la Banque commune d'épreuves. Savoir contextualiser une réflexion, posséder des capacités de discernement, organiser une pensée, cela peut être utile quand on lance un produit en permettant, par exemple, de faire la distinction entre l'essentiel et l'accessoire. La culture générale est aussi un atout dans un monde où l'ouverture d'esprit est valorisée : elle est une couche de vernis indispensable à la coloration intellectuelle d'une carrière. " La culture générale paraît en outre essentielle à tous ceux qui dénoncent les ravages de l'hyperspécialisation : en puisant dans plusieurs disciplines, en se hissant au-dessus des connaissances professionnelles, la culture générale permet, selon eux, d'échapper à la technicisation croissante du monde contemporain. Pour les philosophes Chantal Delsol et Jean-François Mattéi, ce savoir partagé est la marque de l'" honnête homme, qui, selon Diderot, agit en tout par raison ". " Avec la suppression de la culture générale, nous risquons de former des esclaves qui ne lisent rien, qui ne sont pas au courant, qui appliquent simplement, scotchés à leur ordinateur, la perspective technique de la mise en coupe technique de l'humanité qui est en cours d'une façon absolument mondiale ", ajoute l'écrivain Philippe Sollers. Françoise Melonio entend cette inquiétude, même si elle n'en tire pas les mêmes conclusions. " Nous assistons, c'est vrai, à un éclatement progressif des savoirs, constate la doyenne du collège universitaire de Sciences Po. Dans ce contexte, la consolidation d'une culture commune est indispensable, car elle permet de lutter contre l'émiettement du monde. Nous estimons, à Sciences Po, que, à 17 ans, la culture générale n'est pas un bon outil de sélection ; mais nous souhaitons en revanche qu'elle irrigue l'ensemble du travail des étudiants. Nous proposons donc un cursus généraliste qui aborde les questions communes sous l'angle de plusieurs disciplines et nous imposons, en première et deuxième année, des cours d'humanités et des ateliers artistiques (théâtre, architecture, danse, cinéma, écriture, musique) qui mêlent réflexion théorique, sens critique et pratique d'une discipline. " Si la dissertation de culture générale est décriée, c'est en raison du caractère rhétorique d'une épreuve un brin désuète qui encourage souvent les étudiants à formuler des idées superficielles en les agrémentant de quelques citations. Nul besoin de révisions approfondies ou d'un travail de fond sur un programme, comme en français, en histoire ou en philosophie : la dissertation de culture générale, qui ne se nourrit pas de connaissances à proprement parler, picore souvent ici et là des références puisées dans de courtes fiches. Les forums étudiants du Net montrent d'ailleurs que les candidats maîtrisent fort bien les ficelles de l'exercice : l'essentiel, disent-ils, est de masquer ses lacunes, de faire un plan " à la française " et de parsemer sa copie de références culturelles, même mal maîtrisées. En France, la " culture générale " n'a d'ailleurs de générale que le nom : elle méconnaît des pans entiers de l'univers du savoir. La littérature, la philosophie, l'histoire et les arts sont fortement privilégiés, mais la culture scientifique, les savoirs techniques, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire économique, les sciences de la nature, de l'environnement ou de la santé sont regardés avec une certaine condescendance. " La culture, comme le "bon goût", n'est pas une notion objective déposée au Bureau international des poids et mesures de Sèvres, sourit Marie Duru-Bellat, sociologue à Sciences Po. Elle dépend évidemment de ceux qui en définissent les contours. En France, nous avons une conception plutôt élitiste et traditionnelle de la culture générale, et nous sélectionnons nos futurs dirigeants sur ces critères. Le mépris des savoirs empiriques et scientifiques est pourtant regrettable : dans un monde où les questions d'environnement sont centrales, la culture scientifique, ce n'est pas un détail ! " Est-ce en raison de cette tradition de lettrés ? La dissertation de culture générale est, du point de vue social, l'une des épreuves les plus discriminantes qui soient. " Elle élimine tous ceux qui n'ont pas les bons codes, souvent hérités du milieu familial, expliquait en 2008 le ministre de la fonction publique, André Santini. C'est une forme de discrimination invisible. Or, la fonction publique doit jouer son rôle d'ascenseur social, d'intégration et se montrer à l'image de la population. " Beaucoup d'intellectuels contestent cette idée - " la culture générale n'est d'aucun pays et d'aucune classe sociale ", affirment ainsi Chantal Delsol et Jean-François Mattéi -, mais les résultats des recherches scientifiques sont sans ambiguïté : la dissertation de culture générale " à la française " est un puissant facteur d'exclusion sociale. En 2008, trois chercheurs de l'INED (Mireille Eberhard, Dominique Meurs et Patrick Simon) ont analysé le parcours de 1 800 candidats au concours des instituts régionaux d'administration, qui forment les attachés. Les deuxièmes générations de l'immigration réussissent les notes de synthèse aussi bien que les autres candidats, mais elles trébuchent sur la dissertation de culture générale : elles obtiennent en moyenne une note de 8,4 sur 20, contre 9,1 pour les " natifs ". " Même ceux qui ont suivi une préparation au concours ne rattrapent pas le niveau, alors qu'ils progressent dans les autres matières, observe Dominique Meurs. Comme si la culture générale relevait non pas de connaissances ou de capacités de raisonnement acquises à l'école, mais de quelque chose d'indicible qui se transmet dans le milieu social. " Dans les concours d'entrée des écoles de management, les boursiers semblent, eux aussi, partir avec un handicap : l'étude des 150 000 notes du concours 2010 montre qu'ils affichent un retard de 0,9 point en " culture gé " - moins qu'en langue ou en maths, mais plus qu'en économie ou en dossier de synthèse. Pour les sociologues, cette difficulté est liée au fait qu'ils manient mal les " codes " d'une épreuve où les manières comptent au moins autant que le fond. " La dissertation de culture générale fait appel à une tournure d'esprit, une assurance, un goût pour l'abstraction, une façon de présenter ses idées, de mettre la bonne citation au bon endroit, qui s'apprend dans les milieux favorisés, poursuit Dominique Meurs. Cette aisance est le fruit d'un apprentissage culturel, au même titre que la façon de se tenir à table. " Pour lutter contre cette discrimination invisible, le gouvernement a engagé en 2008 une révision générale des concours de la fonction publique. Inspirée par le rapport de deux inspecteurs généraux de l'administration, Corinne Desforges et Jean-Guy de Chalvron - dédié à " Marie-Madeleine de La Vergne, comtesse de La Fayette, et à la princesse de Clèves " -, cette réforme a touché plus de 420 concours. " Les longues dissertations générales favorisaient les candidats issus de milieux favorisés et avaient peu de rapport avec le métier exercé plus tard, explique-t-on au cabinet du ministre de la fonction publique, François Sauvadet. Nous privilégions désormais les études de cas, les notes de synthèse, les mises en situation, qui permettent de mesurer non un bagage culturel mais de réelles aptitudes professionnelles. Cela correspond à une attente de l'Etat, mais aussi des usagers. " Pour limiter l'" effet ségrégatif " des épreuves de culture générale, Salima Saa, la présidente de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, propose, elle, que les épreuves de culture générale s'appuient désormais sur un programme clairement défini. C'est ce que font déjà les 25 écoles de management réunies dans la Banque commune d'épreuves, qui choisissent tous les ans un thème de réflexion étudié en classe préparatoire : la beauté en 2009, la vie en 2010, l'imagination en 2011. " Ces cours leur permettent d'acquérir des repères intellectuels qui les aident à rédiger leur dissertation de culture générale, souligne Thierry Debay, le directeur des admissions et concours de la Banque commune d'épreuves. Mais le système éducatif est implacable : en France, la discrimination sociale commence très tôt, dès le primaire. Il est difficile de redresser la situation aussi tardivement. " L'école française est, il est vrai, une championne des inégalités sociales : la dernière enquête PISA (Programme international pour le suivi des élèves), qui date de 2009, montre que, malgré tous les grands discours sur l'égalité républicaine, le poids du milieu économique et social de l'enfant pèse plus lourdement en France qu'ailleurs : la " variance " liée aux origines sociales atteint 16,7 % dans l'Hexagone, contre seulement 6,2 % en Islande, 7,8 % en Finlande, 8,6 % au Canada, 11,8 % en Italie, 13,7 % au Royaume-Uni, 14,5 % au Danemark. Le travail d'ouverture sociale mené par Science Po sous la direction de Richard Descoings est évidemment utile - en treize ans, le pourcentage d'enfants d'ouvriers a triplé, passant de 1,5 à 4,5 % -, mais il intervient à un âge où les destins sociaux sont, pour l'essentiel, déjà joués. Comme le signale l'ex-président de la Conférence des grandes écoles, Alain Cadix : " L'ascenseur social ne démarre pas au quinzième étage ! ". Anne Chemin |
samedi 14 avril 2012
jeudi 12 avril 2012
Niels Bohr - 1885-1962
Le physicien Niels Bohr - 1885-1962 - l'avait bien compris :
les idées nouvelles ne s'imposent pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que l'ancienne génération a pris sa retraite !
mardi 10 avril 2012
La Mécanique des femmes de Louis Calaferte
- Tu sais qui je suis?
Ironique.
- Une débauchée.
Son mouvement lascif.
- Débauchée, luxurieuse, corrompue, déréglée, voluptueuse, immorale, libertine, dissolue, sensuelle, polissonne, baiseuse, dépravée, impudique, vicieuse.
Me baisant la main avec une feinte dévotion.
- Et malgré tout ça, je veux qu'on m'aime
Ironique.
- Une débauchée.
Son mouvement lascif.
- Débauchée, luxurieuse, corrompue, déréglée, voluptueuse, immorale, libertine, dissolue, sensuelle, polissonne, baiseuse, dépravée, impudique, vicieuse.
Me baisant la main avec une feinte dévotion.
- Et malgré tout ça, je veux qu'on m'aime
Avis aux fumeurs…
« Vu la loi du 2 août 1872 ; la loi du 15 mars 1873 ; vu l’article 6 de la loi du 29 septembre 1917 ; vu les décrets des 30 décembre 1911, 27 janvier 1912, 1er octobre 1917n 26 mai 1919,14 février, 24 août 1921, 7 mai 1923, , 15 juin, 31 juillet, 1925, 3 avril, 28 avril, 9 mai, 1er juin, 10 août 1926, 4 janvier 1928, 20 juin 1930 et 23 mai 1931.
« Sur le rapport du ministre du budget, décrète :
Article premier.
– L’Administration des Manufactures de l’état est autorisée à ramener de 28 à 24 allumettes la contenance des pochettes d’allumettes plates en bois, désignées dans la nomenclature sous le numéro103.
(Journal officiel, 27 février 1932)
samedi 7 avril 2012
mercredi 4 avril 2012
Histoire de la poste
On trouve sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale un ouvrage passionnant intitulé " Les postes françaises : recherches historiques sur leur origine, leur développement, leur législation", par Alexis Belloc (1840-19..) Firmin-Didot (Paris).
Page 86 dans un chapitre consacré au premier essai d'établissement de la petite poste à Paris en 1653 M.de Velayer explique avec esprit la teneur de son invention.
Inscription à :
Articles (Atom)
