*
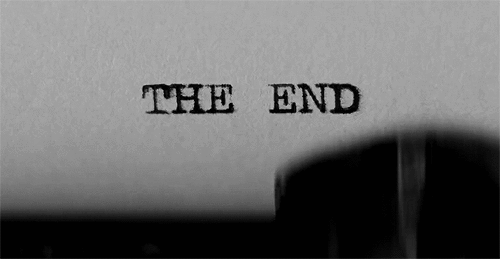

mercredi 28 mai 2014
jeudi 22 mai 2014
le système de protection sociale européen au patrimoine de l'humanité
Sous un tonnerre d'applaudissement, celui qui construisit
les fondements de l'Etat-providence en Espagne, l'ancien président du gouvernement espagnol (1982-1998) Felipe Gonzalez, a repris une citation de
l'ancien président brésilien Luiz Inacio " Lula " Da Silva, selon qui " le système de protection sociale européen devrait être classé au patrimoine de l'humanité ".
Jessye Norman, "Mon coeur s'ouvre à ta voix". SAMSON ET DALILA, Camille ...
Mon cœur s'ouvre à ta voix,
comme s'ouvrent les fleurs
aux baisers de l'aurore!
Mais, ô mon bienaimé,
pour mieux sécher mes pleurs,
que ta voix parle encore!
Dis-moi qu'à Dalila
tu reviens pour jamais.
Redis à ma tendresse
les serments d'autrefois,
ces serments que j'aimais!
Ah! réponds à ma tendresse!
Verse-moi, verse-moi l'ivresse!
Samson! Samson! Je t'aime!
Ainsi qu'on voit des blés
les épis onduler
sous la brise légère,
ainsi frémit mon coeur,
prêt à se consoler,
à ta voix qui m'est chère!
La flèche est moins rapide
à porter le trépas,
que ne l'est ton amante
à voler dans tes bras!
Ah! réponds à ma tendresse!
Verse-moi, verse-moi l'ivresse!
Samson! Samson! Je t'aime!
mercredi 21 mai 2014
lundi 19 mai 2014
On the Duty of Civil Disobedience
by Henry David Thoreau
[1849, original title: Resistance to Civil Goverment]I heartily accept the motto, "That government is best which governs least"; and I should like to see it acted up to more rapidly and systematically. Carried out, it finally amounts to this, which also I believe—"That government is best which governs not at all"; and when men are prepared for it, that will be the kind of government which they will have. Government is at best but an expedient; but most governments are usually, and all governments are sometimes, inexpedient. The objections which have been brought against a standing army, and they are many and weighty, and deserve to prevail, may also at last be brought against a standing government. The standing army is only an arm of the standing government. The government itself, which is only the mode which the people have chosen to execute their will, is equally liable to be abused and perverted before the people can act through it. Witness the present Mexican war, the work of comparatively a few individuals using the standing government as their tool; for in the outset, the people would not have consented to this measure.
This American government—what is it but a tradition, though a recent one, endeavoring to transmit itself unimpaired to posterity, but each instant losing some of its integrity? It has not the vitality and force of a single living man; for a single man can bend it to his will. It is a sort of wooden gun to the people themselves. But it is not the less necessary for this; for the people must have some complicated machinery or other, and hear its din, to satisfy that idea of government which they have. Governments show thus how successfully men can be imposed upon, even impose on themselves, for their own advantage. It is excellent, we must all allow. Yet this government never of itself furthered any enterprise, but by the alacrity with which it got out of its way. It does not keep the country free. It does not settle the West. It does not educate. The character inherent in the American people has done all that has been accomplished; and it would have done somewhat more, if the government had not sometimes got in its way. For government is an expedient, by which men would fain succeed in letting one another alone; and, as has been said, when it is most expedient, the governed are most let alone by it. Trade and commerce, if they were not made of india-rubber, would never manage to bounce over obstacles which legislators are continually putting in their way; and if one were to judge these men wholly by the effects of their actions and not partly by their intentions, they would deserve to be classed and punished with those mischievious persons who put obstructions on the railroads.
But, to speak practically and as a citizen, unlike those who call themselves no-government men, I ask for, not at once no government, but at once a better government. Let every man make known what kind of government would command his respect, and that will be one step toward obtaining it.
After all, the practical reason why, when the power is once in the hands of the people, a majority are permitted, and for a long period continue, to rule is not because they are most likely to be in the right, nor because this seems fairest to the minority, but because they are physically the strongest. But a government in which the majority rule in all cases can not be based on justice, even as far as men understand it. Can there not be a government in which the majorities do not virtually decide right and wrong, but conscience?—in which majorities decide only those questions to which the rule of expediency is applicable? Must the citizen ever for a moment, or in the least degree, resign his conscience to the legislator? Why has every man a conscience then? I think that we should be men first, and subjects afterward. It is not desirable to cultivate a respect for the law, so much as for the right. The only obligation which I have a right to assume is to do at any time what I think right. It is truly enough said that a corporation has no conscience; but a corporation of conscientious men is a corporation with a conscience. Law never made men a whit more just; and, by means of their respect for it, even the well-disposed are daily made the agents on injustice. A common and natural result of an undue respect for the law is, that you may see a file of soldiers, colonel, captain, corporal, privates, powder-monkeys, and all, marching in admirable order over hill and dale to the wars, against their wills, ay, against their common sense and consciences, which makes it very steep marching indeed, and produces a palpitation of the heart. They have no doubt that it is a damnable business in which they are concerned; they are all peaceably inclined. Now, what are they? Men at all? or small movable forts and magazines, at the service of some unscrupulous man in power? Visit the Navy Yard, and behold a marine, such a man as an American government can make, or such as it can make a man with its black arts—a mere shadow and reminiscence of humanity, a man laid out alive and standing, and already, as one may say, buried under arms with funeral accompaniment, though it may be,
"Not a drum was heard, not a funeral note,
As his corse to the rampart we hurried;
Not a soldier discharged his farewell shot
O'er the grave where our hero was buried."
The mass of men serve the state thus, not as men mainly, but as machines, with their bodies. They are the standing army, and the militia, jailers, constables, posse comitatus, etc. In most cases there is no free exercise whatever of the judgement or of the moral sense; but they put themselves on a level with wood and earth and stones; and wooden men can perhaps be manufactured that will serve the purpose as well. Such command no more respect than men of straw or a lump of dirt. They have the same sort of worth only as horses and dogs. Yet such as these even are commonly esteemed good citizens. Others—as most legislators, politicians, lawyers, ministers, and office-holders—serve the state chiefly with their heads; and, as they rarely make any moral distinctions, they are as likely to serve the devil, without intending it, as God. A very few—as heroes, patriots, martyrs, reformers in the great sense, and men—serve the state with their consciences also, and so necessarily resist it for the most part; and they are commonly treated as enemies by it. A wise man will only be useful as a man, and will not submit to be "clay," and "stop a hole to keep the wind away," but leave that office to his dust at least:
"I am too high born to be propertied,
To be a second at control,
Or useful serving-man and instrument
To any sovereign state throughout the world."
He who gives himself entirely to his fellow men appears to them useless and selfish; but he who gives himself partially to them is pronounced a benefactor and philanthropist.
How does it become a man to behave toward the American government today? I answer, that he cannot without disgrace be associated with it. I cannot for an instant recognize that political organization as my government which is the slave's government also.
All men recognize the right of revolution; that is, the right to refuse allegiance to, and to resist, the government, when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable. But almost all say that such is not the case now. But such was the case, they think, in the Revolution of '75. If one were to tell me that this was a bad government because it taxed certain foreign commodities brought to its ports, it is most probable that I should not make an ado about it, for I can do without them. All machines have their friction; and possibly this does enough good to counter-balance the evil. At any rate, it is a great evil to make a stir about it. But when the friction comes to have its machine, and oppression and robbery are organized, I say, let us not have such a machine any longer. In other words, when a sixth of the population of a nation which has undertaken to be the refuge of liberty are slaves, and a whole country is unjustly overrun and conquered by a foreign army, and subjected to military law, I think that it is not too soon for honest men to rebel and revolutionize. What makes this duty the more urgent is that fact that the country so overrun is not our own, but ours is the invading army.
Paley, a common authority with many on moral questions, in his chapter on the "Duty of Submission to Civil Government," resolves all civil obligation into expediency; and he proceeds to say that "so long as the interest of the whole society requires it, that is, so long as the established government cannot be resisted or changed without public inconvenience, it is the will of God . . . that the established government be obeyed—and no longer. This principle being admitted, the justice of every particular case of resistance is reduced to a computation of the quantity of the danger and grievance on the one side, and of the probability and expense of redressing it on the other." Of this, he says, every man shall judge for himself. But Paley appears never to have contemplated those cases to which the rule of expediency does not apply, in which a people, as well as an individual, must do justice, cost what it may. If I have unjustly wrested a plank from a drowning man, I must restore it to him though I drown myself. This, according to Paley, would be inconvenient. But he that would save his life, in such a case, shall lose it. This people must cease to hold slaves, and to make war on Mexico, though it cost them their existence as a people.
In their practice, nations agree with Paley; but does anyone think that Massachusetts does exactly what is right at the present crisis?
"A drab of stat,
a cloth-o'-silver slut,
To have her train borne up,
and her soul trail in the dirt."
Practically speaking, the opponents to a reform in Massachusetts are not a hundred thousand politicians at the South, but a hundred thousand merchants and farmers here, who are more interested in commerce and agriculture than they are in humanity, and are not prepared to do justice to the slave and to Mexico, cost what it may. I quarrel not with far-off foes, but with those who, near at home, co-operate with, and do the bidding of, those far away, and without whom the latter would be harmless. We are accustomed to say, that the mass of men are unprepared; but improvement is slow, because the few are not as materially wiser or better than the many. It is not so important that many should be good as you, as that there be some absolute goodness somewhere; for that will leaven the whole lump. There are thousands who are in opinion opposed to slavery and to the war, who yet in effect do nothing to put an end to them; who, esteeming themselves children of Washington and Franklin, sit down with their hands in their pockets, and say that they know not what to do, and do nothing; who even postpone the question of freedom to the question of free trade, and quietly read the prices-current along with the latest advices from Mexico, after dinner, and, it may be, fall asleep over them both. What is the price-current of an honest man and patriot today? They hesitate, and they regret, and sometimes they petition; but they do nothing in earnest and with effect. They will wait, well disposed, for other to remedy the evil, that they may no longer have it to regret. At most, they give up only a cheap vote, and a feeble countenance and Godspeed, to the right, as it goes by them. There are nine hundred and ninety-nine patrons of virtue to one virtuous man. But it is easier to deal with the real possessor of a thing than with the temporary guardian of it.
All voting is a sort of gaming, like checkers or backgammon, with a slight moral tinge to it, a playing with right and wrong, with moral questions; and betting naturally accompanies it. The character of the voters is not staked. I cast my vote, perchance, as I think right; but I am not vitally concerned that that right should prevail. I am willing to leave it to the majority. Its obligation, therefore, never exceeds that of expediency. Even voting for the right is doing nothing for it. It is only expressing to men feebly your desire that it should prevail. A wise man will not leave the right to the mercy of chance, nor wish it to prevail through the power of the majority. There is but little virtue in the action of masses of men. When the majority shall at length vote for the abolition of slavery, it will be because they are indifferent to slavery, or because there is but little slavery left to be abolished by their vote. They will then be the only slaves. Only his vote can hasten the abolition of slavery who asserts his own freedom by his vote.
I hear of a convention to be held at Baltimore, or elsewhere, for the selection of a candidate for the Presidency, made up chiefly of editors, and men who are politicians by profession; but I think, what is it to any independent, intelligent, and respectable man what decision they may come to? Shall we not have the advantage of this wisdom and honesty, nevertheless? Can we not count upon some independent votes? Are there not many individuals in the country who do not attend conventions? But no: I find that the respectable man, so called, has immediately drifted from his position, and despairs of his country, when his country has more reasons to despair of him. He forthwith adopts one of the candidates thus selected as the only available one, thus proving that he is himself available for any purposes of the demagogue. His vote is of no more worth than that of any unprincipled foreigner or hireling native, who may have been bought. O for a man who is a man, and, as my neighbor says, has a bone in his back which you cannot pass your hand through! Our statistics are at fault: the population has been returned too large. How many men are there to a square thousand miles in the country? Hardly one. Does not America offer any inducement for men to settle here? The American has dwindled into an Odd Fellow—one who may be known by the development of his organ of gregariousness, and a manifest lack of intellect and cheerful self-reliance; whose first and chief concern, on coming into the world, is to see that the almshouses are in good repair; and, before yet he has lawfully donned the virile garb, to collect a fund to the support of the widows and orphans that may be; who, in short, ventures to live only by the aid of the Mutual Insurance company, which has promised to bury him decently.
It is not a man's duty, as a matter of course, to devote himself to the eradication of any, even to most enormous wrong; he may still properly have other concerns to engage him; but it is his duty, at least, to wash his hands of it, and, if he gives it no thought longer, not to give it practically his support. If I devote myself to other pursuits and contemplations, I must first see, at least, that I do not pursue them sitting upon another man's shoulders. I must get off him first, that he may pursue his contemplations too. See what gross inconsistency is tolerated. I have heard some of my townsmen say, "I should like to have them order me out to help put down an insurrection of the slaves, or to march to Mexico—see if I would go"; and yet these very men have each, directly by their allegiance, and so indirectly, at least, by their money, furnished a substitute. The soldier is applauded who refuses to serve in an unjust war by those who do not refuse to sustain the unjust government which makes the war; is applauded by those whose own act and authority he disregards and sets at naught; as if the state were penitent to that degree that it hired one to scourge it while it sinned, but not to that degree that it left off sinning for a moment. Thus, under the name of Order and Civil Government, we are all made at last to pay homage to and support our own meanness. After the first blush of sin comes its indifference; and from immoral it becomes, as it were, unmoral, and not quite unnecessary to that life which we have made.
The broadest and most prevalent error requires the most disinterested virtue to sustain it. The slight reproach to which the virtue of patriotism is commonly liable, the noble are most likely to incur. Those who, while they disapprove of the character and measures of a government, yield to it their allegiance and support are undoubtedly its most conscientious supporters, and so frequently the most serious obstacles to reform. Some are petitioning the State to dissolve the Union, to disregard the requisitions of the President. Why do they not dissolve it themselves—the union between themselves and the State—and refuse to pay their quota into its treasury? Do not they stand in same relation to the State that the State does to the Union? And have not the same reasons prevented the State from resisting the Union which have prevented them from resisting the State?
How can a man be satisfied to entertain an opinion merely, and enjoy it? Is there any enjoyment in it, if his opinion is that he is aggrieved? If you are cheated out of a single dollar by your neighbor, you do not rest satisfied with knowing you are cheated, or with saying that you are cheated, or even with petitioning him to pay you your due; but you take effectual steps at once to obtain the full amount, and see to it that you are never cheated again. Action from principle, the perception and the performance of right, changes things and relations; it is essentially revolutionary, and does not consist wholly with anything which was. It not only divided States and churches, it divides families; ay, it divides the individual, separating the diabolical in him from the divine.
Unjust laws exist: shall we be content to obey them, or shall we endeavor to amend them, and obey them until we have succeeded, or shall we transgress them at once? Men, generally, under such a government as this, think that they ought to wait until they have persuaded the majority to alter them. They think that, if they should resist, the remedy would be worse than the evil. But it is the fault of the government itself that the remedy is worse than the evil. It makes it worse. Why is it not more apt to anticipate and provide for reform? Why does it not cherish its wise minority? Why does it cry and resist before it is hurt? Why does it not encourage its citizens to put out its faults, and do better than it would have them? Why does it always crucify Christ and excommunicate Copernicus and Luther, and pronounce Washington and Franklin rebels?
One would think, that a deliberate and practical denial of its authority was the only offense never contemplated by its government; else, why has it not assigned its definite, its suitable and proportionate, penalty? If a man who has no property refuses but once to earn nine shillings for the State, he is put in prison for a period unlimited by any law that I know, and determined only by the discretion of those who put him there; but if he should steal ninety times nine shillings from the State, he is soon permitted to go at large again.
If the injustice is part of the necessary friction of the machine of government, let it go, let it go: perchance it will wear smooth—certainly the machine will wear out. If the injustice has a spring, or a pulley, or a rope, or a crank, exclusively for itself, then perhaps you may consider whether the remedy will not be worse than the evil; but if it is of such a nature that it requires you to be the agent of injustice to another, then I say, break the law. Let your life be a counter-friction to stop the machine. What I have to do is to see, at any rate, that I do not lend myself to the wrong which I condemn.
As for adopting the ways of the State has provided for remedying the evil, I know not of such ways. They take too much time, and a man's life will be gone. I have other affairs to attend to. I came into this world, not chiefly to make this a good place to live in, but to live in it, be it good or bad. A man has not everything to do, but something; and because he cannot do everything, it is not necessary that he should be doing something wrong. It is not my business to be petitioning the Governor or the Legislature any more than it is theirs to petition me; and if they should not hear my petition, what should I do then? But in this case the State has provided no way: its very Constitution is the evil. This may seem to be harsh and stubborn and unconcilliatory; but it is to treat with the utmost kindness and consideration the only spirit that can appreciate or deserves it. So is all change for the better, like birth and death, which convulse the body.
I do not hesitate to say, that those who call themselves Abolitionists should at once effectually withdraw their support, both in person and property, from the government of Massachusetts, and not wait till they constitute a majority of one, before they suffer the right to prevail through them. I think that it is enough if they have God on their side, without waiting for that other one. Moreover, any man more right than his neighbors constitutes a majority of one already.
I meet this American government, or its representative, the State government, directly, and face to face, once a year—no more—in the person of its tax-gatherer; this is the only mode in which a man situated as I am necessarily meets it; and it then says distinctly, Recognize me; and the simplest, the most effectual, and, in the present posture of affairs, the indispensablest mode of treating with it on this head, of expressing your little satisfaction with and love for it, is to deny it then. My civil neighbor, the tax-gatherer, is the very man I have to deal with—for it is, after all, with men and not with parchment that I quarrel—and he has voluntarily chosen to be an agent of the government. How shall he ever know well that he is and does as an officer of the government, or as a man, until he is obliged to consider whether he will treat me, his neighbor, for whom he has respect, as a neighbor and well-disposed man, or as a maniac and disturber of the peace, and see if he can get over this obstruction to his neighborlines without a ruder and more impetuous thought or speech corresponding with his action. I know this well, that if one thousand, if one hundred, if ten men whom I could name—if ten honest men only—ay, if one HONEST man, in this State of Massachusetts, ceasing to hold slaves, were actually to withdraw from this co-partnership, and be locked up in the county jail therefor, it would be the abolition of slavery in America. For it matters not how small the beginning may seem to be: what is once well done is done forever. But we love better to talk about it: that we say is our mission. Reform keeps many scores of newspapers in its service, but not one man. If my esteemed neighbor, the State's ambassador, who will devote his days to the settlement of the question of human rights in the Council Chamber, instead of being threatened with the prisons of Carolina, were to sit down the prisoner of Massachusetts, that State which is so anxious to foist the sin of slavery upon her sister—though at present she can discover only an act of inhospitality to be the ground of a quarrel with her—the Legislature would not wholly waive the subject of the following winter.
Under a government which imprisons unjustly, the true place for a just man is also a prison. The proper place today, the only place which Massachusetts has provided for her freer and less despondent spirits, is in her prisons, to be put out and locked out of the State by her own act, as they have already put themselves out by their principles. It is there that the fugitive slave, and the Mexican prisoner on parole, and the Indian come to plead the wrongs of his race should find them; on that separate but more free and honorable ground, where the State places those who are not with her, but against her—the only house in a slave State in which a free man can abide with honor. If any think that their influence would be lost there, and their voices no longer afflict the ear of the State, that they would not be as an enemy within its walls, they do not know by how much truth is stronger than error, nor how much more eloquently and effectively he can combat injustice who has experienced a little in his own person. Cast your whole vote, not a strip of paper merely, but your whole influence. A minority is powerless while it conforms to the majority; it is not even a minority then; but it is irresistible when it clogs by its whole weight. If the alternative is to keep all just men in prison, or give up war and slavery, the State will not hesitate which to choose. If a thousand men were not to pay their tax bills this year, that would not be a violent and bloody measure, as it would be to pay them, and enable the State to commit violence and shed innocent blood. This is, in fact, the definition of a peaceable revolution, if any such is possible. If the tax-gatherer, or any other public officer, asks me, as one has done, "But what shall I do?" my answer is, "If you really wish to do anything, resign your office." When the subject has refused allegiance, and the officer has resigned from office, then the revolution is accomplished. But even suppose blood should flow. Is there not a sort of blood shed when the conscience is wounded? Through this wound a man's real manhood and immortality flow out, and he bleeds to an everlasting death. I see this blood flowing now.
I have contemplated the imprisonment of the offender, rather than the seizure of his goods—though both will serve the same purpose—because they who assert the purest right, and consequently are most dangerous to a corrupt State, commonly have not spent much time in accumulating property. To such the State renders comparatively small service, and a slight tax is wont to appear exorbitant, particularly if they are obliged to earn it by special labor with their hands. If there were one who lived wholly without the use of money, the State itself would hesitate to demand it of him. But the rich man—not to make any invidious comparison—is always sold to the institution which makes him rich. Absolutely speaking, the more money, the less virtue; for money comes between a man and his objects, and obtains them for him; it was certainly no great virtue to obtain it. It puts to rest many questions which he would otherwise be taxed to answer; while the only new question which it puts is the hard but superfluous one, how to spend it. Thus his moral ground is taken from under his feet. The opportunities of living are diminished in proportion as that are called the "means" are increased. The best thing a man can do for his culture when he is rich is to endeavor to carry out those schemes which he entertained when he was poor. Christ answered the Herodians according to their condition. "Show me the tribute-money," said he—and one took a penny out of his pocket—if you use money which has the image of Caesar on it, and which he has made current and valuable, that is, if you are men of the State, and gladly enjoy the advantages of Caesar's government, then pay him back some of his own when he demands it. "Render therefore to Caesar that which is Caesar's and to God those things which are God's"—leaving them no wiser than before as to which was which; for they did not wish to know.
When I converse with the freest of my neighbors, I perceive that, whatever they may say about the magnitude and seriousness of the question, and their regard for the public tranquillity, the long and the short of the matter is, that they cannot spare the protection of the existing government, and they dread the consequences to their property and families of disobedience to it. For my own part, I should not like to think that I ever rely on the protection of the State. But, if I deny the authority of the State when it presents its tax bill, it will soon take and waste all my property, and so harass me and my children without end. This is hard. This makes it impossible for a man to live honestly, and at the same time comfortably, in outward respects. It will not be worth the while to accumulate property; that would be sure to go again. You must hire or squat somewhere, and raise but a small crop, and eat that soon. You must live within yourself, and depend upon yourself always tucked up and ready for a start, and not have many affairs. A man may grow rich in Turkey even, if he will be in all respects a good subject of the Turkish government. Confucius said: "If a state is governed by the principles of reason, poverty and misery are subjects of shame; if a state is not governed by the principles of reason, riches and honors are subjects of shame." No: until I want the protection of Massachusetts to be extended to me in some distant Southern port, where my liberty is endangered, or until I am bent solely on building up an estate at home by peaceful enterprise, I can afford to refuse allegiance to Massachusetts, and her right to my property and life. It costs me less in every sense to incur the penalty of disobedience to the State than it would to obey. I should feel as if I were worth less in that case.
Some years ago, the State met me in behalf of the Church, and commanded me to pay a certain sum toward the support of a clergyman whose preaching my father attended, but never I myself. "Pay," it said, "or be locked up in the jail." I declined to pay. But, unfortunately, another man saw fit to pay it. I did not see why the schoolmaster should be taxed to support the priest, and not the priest the schoolmaster; for I was not the State's schoolmaster, but I supported myself by voluntary subscription. I did not see why the lyceum should not present its tax bill, and have the State to back its demand, as well as the Church. However, at the request of the selectmen, I condescended to make some such statement as this in writing: "Know all men by these presents, that I, Henry Thoreau, do not wish to be regarded as a member of any incorporated society which I have not joined." This I gave to the town clerk; and he has it. The State, having thus learned that I did not wish to be regarded as a member of that church, has never made a like demand on me since; though it said that it must adhere to its original presumption that time. If I had known how to name them, I should then have signed off in detail from all the societies which I never signed on to; but I did not know where to find such a complete list.
I have paid no poll tax for six years. I was put into a jail once on this account, for one night; and, as I stood considering the walls of solid stone, two or three feet thick, the door of wood and iron, a foot thick, and the iron grating which strained the light, I could not help being struck with the foolishness of that institution which treated me as if I were mere flesh and blood and bones, to be locked up. I wondered that it should have concluded at length that this was the best use it could put me to, and had never thought to avail itself of my services in some way. I saw that, if there was a wall of stone between me and my townsmen, there was a still more difficult one to climb or break through before they could get to be as free as I was. I did nor for a moment feel confined, and the walls seemed a great waste of stone and mortar. I felt as if I alone of all my townsmen had paid my tax. They plainly did not know how to treat me, but behaved like persons who are underbred. In every threat and in every compliment there was a blunder; for they thought that my chief desire was to stand the other side of that stone wall. I could not but smile to see how industriously they locked the door on my meditations, which followed them out again without let or hindrance, and they were really all that was dangerous. As they could not reach me, they had resolved to punish my body; just as boys, if they cannot come at some person against whom they have a spite, will abuse his dog. I saw that the State was half-witted, that it was timid as a lone woman with her silver spoons, and that it did not know its friends from its foes, and I lost all my remaining respect for it, and pitied it.
Thus the state never intentionally confronts a man's sense, intellectual or moral, but only his body, his senses. It is not armed with superior wit or honesty, but with superior physical strength. I was not born to be forced. I will breathe after my own fashion. Let us see who is the strongest. What force has a multitude? They only can force me who obey a higher law than I. They force me to become like themselves. I do not hear of men being forced to live this way or that by masses of men. What sort of life were that to live? When I meet a government which says to me, "Your money or your life," why should I be in haste to give it my money? It may be in a great strait, and not know what to do: I cannot help that. It must help itself; do as I do. It is not worth the while to snivel about it. I am not responsible for the successful working of the machinery of society. I am not the son of the engineer. I perceive that, when an acorn and a chestnut fall side by side, the one does not remain inert to make way for the other, but both obey their own laws, and spring and grow and flourish as best they can, till one, perchance, overshadows and destroys the other. If a plant cannot live according to nature, it dies; and so a man.
The night in prison was novel and interesting enough. The prisoners in their shirtsleeves were enjoying a chat and the evening air in the doorway, when I entered. But the jailer said, "Come, boys, it is time to lock up"; and so they dispersed, and I heard the sound of their steps returning into the hollow apartments. My room-mate was introduced to me by the jailer as "a first-rate fellow and clever man." When the door was locked, he showed me where to hang my hat, and how he managed matters there. The rooms were whitewashed once a month; and this one, at least, was the whitest, most simply furnished, and probably neatest apartment in town. He naturally wanted to know where I came from, and what brought me there; and, when I had told him, I asked him in my turn how he came there, presuming him to be an honest man, of course; and as the world goes, I believe he was. "Why," said he, "they accuse me of burning a barn; but I never did it." As near as I could discover, he had probably gone to bed in a barn when drunk, and smoked his pipe there; and so a barn was burnt. He had the reputation of being a clever man, had been there some three months waiting for his trial to come on, and would have to wait as much longer; but he was quite domesticated and contented, since he got his board for nothing, and thought that he was well treated.
He occupied one window, and I the other; and I saw that if one stayed there long, his principal business would be to look out the window. I had soon read all the tracts that were left there, and examined where former prisoners had broken out, and where a grate had been sawed off, and heard the history of the various occupants of that room; for I found that even there there was a history and a gossip which never circulated beyond the walls of the jail. Probably this is the only house in the town where verses are composed, which are afterward printed in a circular form, but not published. I was shown quite a long list of young men who had been detected in an attempt to escape, who avenged themselves by singing them.
I pumped my fellow-prisoner as dry as I could, for fear I should never see him again; but at length he showed me which was my bed, and left me to blow out the lamp.
It was like travelling into a far country, such as I had never expected to behold, to lie there for one night. It seemed to me that I never had heard the town clock strike before, not the evening sounds of the village; for we slept with the windows open, which were inside the grating. It was to see my native village in the light of the Middle Ages, and our Concord was turned into a Rhine stream, and visions of knights and castles passed before me. They were the voices of old burghers that I heard in the streets. I was an involuntary spectator and auditor of whatever was done and said in the kitchen of the adjacent village inn—a wholly new and rare experience to me. It was a closer view of my native town. I was fairly inside of it. I never had seen its institutions before. This is one of its peculiar institutions; for it is a shire town. I began to comprehend what its inhabitants were about.
In the morning, our breakfasts were put through the hole in the door, in small oblong-square tin pans, made to fit, and holding a pint of chocolate, with brown bread, and an iron spoon. When they called for the vessels again, I was green enough to return what bread I had left, but my comrade seized it, and said that I should lay that up for lunch or dinner. Soon after he was let out to work at haying in a neighboring field, whither he went every day, and would not be back till noon; so he bade me good day, saying that he doubted if he should see me again.
When I came out of prison—for some one interfered, and paid that tax—I did not perceive that great changes had taken place on the common, such as he observed who went in a youth and emerged a gray-headed man; and yet a change had come to my eyes come over the scene—the town, and State, and country, greater than any that mere time could effect. I saw yet more distinctly the State in which I lived. I saw to what extent the people among whom I lived could be trusted as good neighbors and friends; that their friendship was for summer weather only; that they did not greatly propose to do right; that they were a distinct race from me by their prejudices and superstitions, as the Chinamen and Malays are; that in their sacrifices to humanity they ran no risks, not even to their property; that after all they were not so noble but they treated the thief as he had treated them, and hoped, by a certain outward observance and a few prayers, and by walking in a particular straight though useless path from time to time, to save their souls. This may be to judge my neighbors harshly; for I believe that many of them are not aware that they have such an institution as the jail in their village.
It was formerly the custom in our village, when a poor debtor came out of jail, for his acquaintances to salute him, looking through their fingers, which were crossed to represent the jail window, "How do ye do?" My neighbors did not thus salute me, but first looked at me, and then at one another, as if I had returned from a long journey. I was put into jail as I was going to the shoemaker's to get a shoe which was mended. When I was let out the next morning, I proceeded to finish my errand, and, having put on my mended shoe, joined a huckleberry party, who were impatient to put themselves under my conduct; and in half an hour—for the horse was soon tackled—was in the midst of a huckleberry field, on one of our highest hills, two miles off, and then the State was nowhere to be seen.
This is the whole history of "My Prisons."
I have never declined paying the highway tax, because I am as desirous of being a good neighbor as I am of being a bad subject; and as for supporting schools, I am doing my part to educate my fellow countrymen now. It is for no particular item in the tax bill that I refuse to pay it. I simply wish to refuse allegiance to the State, to withdraw and stand aloof from it effectually. I do not care to trace the course of my dollar, if I could, till it buys a man or a musket to shoot one with—the dollar is innocent—but I am concerned to trace the effects of my allegiance. In fact, I quietly declare war with the State, after my fashion, though I will still make use and get what advantages of her I can, as is usual in such cases.
If others pay the tax which is demanded of me, from a sympathy with the State, they do but what they have already done in their own case, or rather they abet injustice to a greater extent than the State requires. If they pay the tax from a mistaken interest in the individual taxed, to save his property, or prevent his going to jail, it is because they have not considered wisely how far they let their private feelings interfere with the public good.
This, then, is my position at present. But one cannot be too much on his guard in such a case, lest his actions be biased by obstinacy or an undue regard for the opinions of men. Let him see that he does only what belongs to himself and to the hour.
I think sometimes, Why, this people mean well, they are only ignorant; they would do better if they knew how: why give your neighbors this pain to treat you as they are not inclined to? But I think again, This is no reason why I should do as they do, or permit others to suffer much greater pain of a different kind. Again, I sometimes say to myself, When many millions of men, without heat, without ill will, without personal feelings of any kind, demand of you a few shillings only, without the possibility, such is their constitution, of retracting or altering their present demand, and without the possibility, on your side, of appeal to any other millions, why expose yourself to this overwhelming brute force? You do not resist cold and hunger, the winds and the waves, thus obstinately; you quietly submit to a thousand similar necessities. You do not put your head into the fire. But just in proportion as I regard this as not wholly a brute force, but partly a human force, and consider that I have relations to those millions as to so many millions of men, and not of mere brute or inanimate things, I see that appeal is possible, first and instantaneously, from them to the Maker of them, and, secondly, from them to themselves. But if I put my head deliberately into the fire, there is no appeal to fire or to the Maker of fire, and I have only myself to blame. If I could convince myself that I have any right to be satisfied with men as they are, and to treat them accordingly, and not according, in some respects, to my requisitions and expectations of what they and I ought to be, then, like a good Mussulman and fatalist, I should endeavor to be satisfied with things as they are, and say it is the will of God. And, above all, there is this difference between resisting this and a purely brute or natural force, that I can resist this with some effect; but I cannot expect, like Orpheus, to change the nature of the rocks and trees and beasts.
I do not wish to quarrel with any man or nation. I do not wish to split hairs, to make fine distinctions, or set myself up as better than my neighbors. I seek rather, I may say, even an excuse for conforming to the laws of the land. I am but too ready to conform to them. Indeed, I have reason to suspect myself on this head; and each year, as the tax-gatherer comes round, I find myself disposed to review the acts and position of the general and State governments, and the spirit of the people to discover a pretext for conformity.
"We must affect our country as our parents,
And if at any time we alienate
Out love or industry from doing it honor,
We must respect effects and teach the soul
Matter of conscience and religion,
And not desire of rule or benefit."
I believe that the State will soon be able to take all my work of this sort out of my hands, and then I shall be no better patriot than my fellow-countrymen. Seen from a lower point of view, the Constitution, with all its faults, is very good; the law and the courts are very respectable; even this State and this American government are, in many respects, very admirable, and rare things, to be thankful for, such as a great many have described them; seen from a higher still, and the highest, who shall say what they are, or that they are worth looking at or thinking of at all?
However, the government does not concern me much, and I shall bestow the fewest possible thoughts on it. It is not many moments that I live under a government, even in this world. If a man is thought-free, fancy-free, imagination-free, that which is not never for a long time appearing to be to him, unwise rulers or reformers cannot fatally interrupt him.
I know that most men think differently from myself; but those whose lives are by profession devoted to the study of these or kindred subjects content me as little as any. Statesmen and legislators, standing so completely within the institution, never distinctly and nakedly behold it. They speak of moving society, but have no resting-place without it. They may be men of a certain experience and discrimination, and have no doubt invented ingenious and even useful systems, for which we sincerely thank them; but all their wit and usefulness lie within certain not very wide limits. They are wont to forget that the world is not governed by policy and expediency. Webster never goes behind government, and so cannot speak with authority about it. His words are wisdom to those legislators who contemplate no essential reform in the existing government; but for thinkers, and those who legislate for all time, he never once glances at the subject. I know of those whose serene and wise speculations on this theme would soon reveal the limits of his mind's range and hospitality. Yet, compared with the cheap professions of most reformers, and the still cheaper wisdom an eloquence of politicians in general, his are almost the only sensible and valuable words, and we thank Heaven for him. Comparatively, he is always strong, original, and, above all, practical. Still, his quality is not wisdom, but prudence. The lawyer's truth is not Truth, but consistency or a consistent expediency. Truth is always in harmony with herself, and is not concerned chiefly to reveal the justice that may consist with wrong-doing. He well deserves to be called, as he has been called, the Defender of the Constitution. There are really no blows to be given him but defensive ones. He is not a leader, but a follower. His leaders are the men of '87. "I have never made an effort," he says, "and never propose to make an effort; I have never countenanced an effort, and never mean to countenance an effort, to disturb the arrangement as originally made, by which various States came into the Union." Still thinking of the sanction which the Constitution gives to slavery, he says, "Because it was part of the original compact—let it stand." Notwithstanding his special acuteness and ability, he is unable to take a fact out of its merely political relations, and behold it as it lies absolutely to be disposed of by the intellect—what, for instance, it behooves a man to do here in American today with regard to slavery—but ventures, or is driven, to make some such desperate answer to the following, while professing to speak absolutely, and as a private man—from which what new and singular of social duties might be inferred? "The manner," says he, "in which the governments of the States where slavery exists are to regulate it is for their own consideration, under the responsibility to their constituents, to the general laws of propriety, humanity, and justice, and to God. Associations formed elsewhere, springing from a feeling of humanity, or any other cause, have nothing whatever to do with it. They have never received any encouragement from me and they never will." [These extracts have been inserted since the lecture was read -HDT]
They who know of no purer sources of truth, who have traced up its stream no higher, stand, and wisely stand, by the Bible and the Constitution, and drink at it there with reverence and humanity; but they who behold where it comes trickling into this lake or that pool, gird up their loins once more, and continue their pilgrimage toward its fountainhead.
No man with a genius for legislation has appeared in America. They are rare in the history of the world. There are orators, politicians, and eloquent men, by the thousand; but the speaker has not yet opened his mouth to speak who is capable of settling the much-vexed questions of the day. We love eloquence for its own sake, and not for any truth which it may utter, or any heroism it may inspire. Our legislators have not yet learned the comparative value of free trade and of freedom, of union, and of rectitude, to a nation. They have no genius or talent for comparatively humble questions of taxation and finance, commerce and manufactures and agriculture. If we were left solely to the wordy wit of legislators in Congress for our guidance, uncorrected by the seasonable experience and the effectual complaints of the people, America would not long retain her rank among the nations. For eighteen hundred years, though perchance I have no right to say it, the New Testament has been written; yet where is the legislator who has wisdom and practical talent enough to avail himself of the light which it sheds on the science of legislation.
The authority of government, even such as I am willing to submit to—for I will cheerfully obey those who know and can do better than I, and in many things even those who neither know nor can do so well—is still an impure one: to be strictly just, it must have the sanction and consent of the governed. It can have no pure right over my person and property but what I concede to it. The progress from an absolute to a limited monarchy, from a limited monarchy to a democracy, is a progress toward a true respect for the individual. Even the Chinese philosopher was wise enough to regard the individual as the basis of the empire. Is a democracy, such as we know it, the last improvement possible in government? Is it not possible to take a step further towards recognizing and organizing the rights of man? There will never be a really free and enlightened State until the State comes to recognize the individual as a higher and independent power, from which all its own power and authority are derived, and treats him accordingly. I please myself with imagining a State at last which can afford to be just to all men, and to treat the individual with respect as a neighbor; which even would not think it inconsistent with its own repose if a few were to live aloof from it, not meddling with it, nor embraced by it, who fulfilled all the duties of neighbors and fellow men. A State which bore this kind of fruit, and suffered it to drop off as fast as it ripened, would prepare the way for a still more perfect and glorious State, which I have also imagined, but not yet anywhere seen.
Discours
de la
servitude
volontaire
Étienne de La Boétie
1549
1549
« Il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres ; n’en ayons qu’un seul ;
Qu’un seul soit le maître, qu’un seul soit le roi. »
Voilà ce que déclara Ulysse en public, selon Homère.
S’il eût dit seulement : « Il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres », c’était suffisant. Mais
au lieu d’en déduire que la domination de plusieurs ne peut être bonne, puisque la puissance d’un
seul, dès qu’il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il ajoute au contraire : « N’ayons
qu’un seul maître... »
Il faut peut-être excuser Ulysse d’avoir tenu ce langage, qui lui servait alors pour apaiser la
révolte de l’armée : je crois qu’il adaptait plutôt son discours aux circonstances qu’à la vérité.
Mais à la réflexion, c’est un malheur extrême que d’être assujetti à un maître dont on ne peut
jamais être assuré de la bonté, et qui a toujours le pouvoir d’être méchant quand il le voudra. Quant
à obéir à plusieurs maîtres, c’est être autant de fois extrêmement malheureux.
Je ne veux pas débattre ici la question tant de fois agitée, à savoir « si d’autres sortes de
républiques sont meilleures que la monarchie ». Si j’avais à la débattre, avant de chercher quel rang
la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique, je demanderais
si l’on doit même lui en accorder aucun, car il est difficile de croire qu’il y ait rien de public dans
ce gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps cette question qui
mériterait bien un traité à part, et qui provoquerait toutes les disputes politiques.
Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d’hommes,
tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n’a de puissance
que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien
l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui que
de le contredire. Chose vraiment étonnante — et pourtant si commune qu’il faut plutôt en gémir
que s’en ébahir -, de voir un million d’hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non
qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et pour ainsi dire
ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient pas redouter — puisqu’il est seul — ni aimer
— puisqu’il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes :
contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les plus forts. Si
donc une nation, contrainte par la force des armes, est soumise au pouvoir d’un seul — comme
la cité d’Athènes le fut à la domination des trente tyrans —, il ne faut pas s’étonner qu’elle serve,
mais bien le déplorer. Ou plutôt, ne s’en étonner ni ne s’en plaindre, mais supporter le malheur
avec patience, et se réserver pour un avenir meilleur.
Nous sommes ainsi faits que les devoirs communs de l’amitié absorbent une bonne part de
notre vie. Il est raisonnable d’aimer la vertu, d’estimer les belles actions, d’être reconnaissants
pour les bienfaits reçus, et de réduire souvent notre propre bien-être pour accroître l’honneur et
l’avantage de ceux que nous aimons, et qui méritent d’être aimés. Si donc les habitants d’un pays
trouvent parmi eux un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves d’une grande prévoyance
pour les sauvegarder, d’une grande hardiesse pour les défendre, d’une grande prudence pour les
gouverner ; s’ils s’habituent à la longue à lui obéir et à se fier à lui jusqu’à lui accorder une certaine
suprématie, je ne sais s’il serait sage de l’enlever de là où il faisait bien pour le placer là où il pourra
faire mal ; il semble, en effet, naturel d’avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré du bien, et
de ne pas en craindre un mal.
Mais, ô grand Dieu, qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce
3
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais servir, non
pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même
qui soient à eux ? De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d’une armée,
non d’un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d’un seul !
Non d’un Hercule ou d’un Samson, mais d’un hommelet souvent le plus lâche, le plus efféminé de
la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles ni guère foulé le sable des tournois, qui n’est
pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette !
Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards ces hommes soumis ? Si deux,
si trois, si quatre cèdent à un seul, c’est étrange, mais toutefois possible ; on pourrait peut-être dire
avec raison : c’est faute de coeur. Mais si cent, si mille souffrent l’oppression d’un seul, dira-ton
encore qu’ils n’osent pas s’en prendre à lui, ou qu’ils ne le veulent pas, et que ce n’est pas
couardise, mais plutôt mépris ou dédain ?
Enfin, si l’on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million
d’hommes ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de serfs et d’esclaves, comment
qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ? Mais tous les vices ont des bornes qu’ils ne peuvent pas
dépasser. Deux hommes, et même dix, peuvent bien en craindre un ; mais que mille, un million,
mille villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n’est pas couardise : elle ne va pas
jusque-là, de même que la vaillance n’exige pas qu’un seul homme escalade une forteresse, attaque
une armée, conquière un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci, qui ne mérite pas même
le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue
refuse de nommer ?. ..
Qu’on mette face à face cinquante mille hommes en armes ; qu’on les range en bataille, qu’ils
en viennent aux mains ; les uns, libres, combattent pour leur liberté, les autres combattent pour la
leur ravir. Auxquels promettrez-vous la victoire ? Lesquels iront le plus courageusement au combat
: ceux qui espèrent pour récompense le maintien de leur liberté, ou ceux qui n’attendent pour
salaire des coups qu’il donnent et qu’ils reçoivent que la servitude d’autrui ? Les uns ont toujours
devant les yeux le bonheur de leur vie passée et l’attente d’un bien-être égal pour l’avenir.
Ils pensent moins à ce qu’ils endurent le temps d’une bataille qu’à ce qu’ils endureraient, vaincus,
eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n’ont pour aiguillon qu’une petite pointe
de convoitise qui s’émousse soudain contre le danger, et dont l’ardeur s’éteint dans le sang de
leur première blessure. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qui
datent de deux mille ans et qui vivent encore aujourd’hui aussi fraîches dans la mémoire des livres
et des hommes que si elles venaient d’être livrées hier, en Grèce, pour le bien des Grecs et pour
l’exemple du monde entier, qu’est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non pas le pouvoir,
mais le courage de supporter la force de tant de navires que la mer elle-même en débordait, de
vaincre des nations si nombreuses que tous les soldats grecs, pris ensemble, n’auraient pas fourni
assez de capitaines aux armées ennemies ? Dans ces journces glorieuses, c’était moins la bataille
des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l’affranchissement sur
la convoitise.
Ils sont vraiment extraordinaires, les récits de la vaillance que la liberté met au coeur de ceux
qui la défendent ! Mais ce qui arrive, partout et tous les jours : qu’un homme seul en opprime cent
mille et les prive de leur liberté, qui pourrait le croire, s’il ne faisait que l’entendre et non le voir ?
Et si cela n’arrivait que dans des pays étrangers, des terres lointaines et qu’on vînt nous le raconter,
qui ne croirait ce récit purement inventé ?
4
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Or ce tyran seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni de l’abattre. Il est défait de lui-même,
pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s’agit pas de lui ôter quelque chose,
mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu
qu’il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui
se font malmener, puisqu’ils en seraient quittes en cessant de servir. C’est le peuple qui s’asservit
et qui se coupe la gorge ; qui, pouvant choisir d’être soumis ou d’être libre, repousse la liberté et
prend le joug ; qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche... S’il lui coûtait quelque chose
pour recouvrer sa liberté, je ne l’en presserais pas ; même si ce qu’il doit avoir le plus à coeur est
de rentrer dans ses droits naturels et, pour ainsi dire, de bête redevenir homme. Mais je n’attends
même pas de lui une si grande hardiesse ; j’admets qu’il aime mieux je ne sais quelle assurance de
vivre misérablement qu’un espoir douteux de vivre comme il l’entend. Mais quoi ! Si pour avoir
la liberté il suffit de la désirer, s’il n’est besoin que d’un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation
au monde qui croie la payer trop cher en l’acquérant par un simple souhait ? Et qui regretterait sa
volonté de recouvrer un bien qu’on devrait racheter au prix du sang, et dont la perte rend à tout
homme d’honneur la vie amère et la mort bienfaisante ? Certes, comme le feu d’une petite étincelle
grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume
et finit par s’éteindre de lui-même quand on cesse de l’alimenter, de même, plus les tyrans pillent,
plus ils exigent ; plus ils ruinent et détruisent, plus où leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient
d’autant, deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on
ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et
défaits et ne sont plus rien, de même que la branche, n’ayant plus de suc ni d’aliment à sa racine,
devient sèche et morte.
Pour acquérir le bien qu’il souhaite, l’homme hardi ne redoute aucun danger, l’homme avisé
n’est rebuté par aucune peine. Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni
recouvrer le bien qu’ils se bornent à convoiter. L’énergie d’y prétendre leur est ravie par leur propre
lâcheté ; il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté commune aux
sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont la
possession les rendrait heureux et contents. il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi,
n’ont pas la force de désirer : c’est la liberté, bien si grand et si doux ! Dès qu’elle est perdue,
tous les maux s’ensuivent, et sans elle tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent
entièrement leur goût et leur saveur. La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semblet-
il, parce que s’ils la désiraient, ils l’auraient ; comme s’ils refusaient de faire cette précieuse
acquisition parce qu’elle est trop aisée.
Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre
bien ! Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous
laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres !
Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais
comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de
vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais
certes bien de l’ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu’il est, de celui pour qui vous
allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir
vous-mêmes à la mort. Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de
plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les
moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient,
si ce n’est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ?
5
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, qui
ne soit de vous-mêmes ? Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec vous ?
Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n’étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices
du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-mêmes ? Vous semez vos champs pour qu’il les
dévaste, vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries, vous élevez vos filles
afin qu’il puisse assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu’il en fasse des soldats
dans le meilleur des cas, pour qu’il les mène à la guerre, à la boucherie, qu’il les rende ministres
de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu’il puisse se
mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu’il
soit plus fort, et qu’il vous tienne plus rudement la bride plus courte. Et de tant d’indignités que les
bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous
essayiez, même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir.
Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de
l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a
brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.
Les médecins conseillent justement de ne pas chercher à guérir les plaies incurables, et peutêtre
ai-je tort de vouloir ainsi exhorter un peuple qui semble avoir perdu depuis longtemps toute
connaissance de son mal — ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons donc à
comprendre, si c’est possible, comment cette opiniâtre volonté de servir s’est enracinée si profond
qu’on croirait que l’amour même de la liberté n’est pas si naturel.
Il est hors de doute, je crois, que si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et
d’après les préceptes qu’elle nous enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets
de la raison, sans être esclaves de personne. Chacun de nous reconnaît en soi, tout naturellement,
l’impulsion de l’obéissance envers ses père et mère. Quant à savoir si la raison est en nous innée ou
non — question débattue amplement par les académies et agitée par toute l’école des philosophes
-, je ne pense pas errer en disant qu’il y a dans notre âme un germe naturel de raison. Développé par
les bons conseils et les bons exemples, ce germe s’épanouit en vertu, mais il avorte souvent, étouffé
par les vices qui surviennent. Ce qu’il y a de clair et d’évident, que personne ne peut ignorer, c’est
que la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous créés et coulés en quelque
sorte dans le même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. Et si,
dans le partage qu’elle a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d’esprit
aux uns plus qu’aux autres, elle n’a cependant pas voulu nous mettre en ce monde comme sur un
champ de bataille, et n’a pas envoyé ici bas les plus forts ou les plus adroits comme des brigands
armés dans une forêt pour y malmener les plus faibles. Croyons plutôt qu’en faisant ainsi des parts
plus grandes aux uns, plus petites aux autres, elle a voulu faire naître en eux l’affection fraternelle
et les mettre à même de la pratiquer, puisque les uns ont la puissance de porter secours tandis que
les autres ont besoin d’en recevoir. Donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la
terre pour demeure, puisqu’elle nous a tous logés dans la même maison, nous a tous formés sur
le même modèle afin que chacun pût se regarder et quasiment se reconnaître dans l’autre comme
dans un miroir, puisqu’elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour mieux
nous rencontrer et fraterniser et pour produire, par la communication et l’échange de nos pensées,
la communion de nos volontés ; puisqu’elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le
noeud de notre alliance, de notre société, puisqu’elle a montré en toutes choses qu’elle ne nous
voulait pas seulement unis, mais tel un seul être, comment douter alors que nous ne soyons tous
naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux ? Il ne peut entrer dans l’esprit de personne
6
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
que la nature ait mis quiconque en servitude, puisqu’elle nous a tous mis en compagnie.
À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu’on ne peut tenir
aucun être en servitude sans lui faire tort : il n’y a rien au monde de plus contraire à la nature,
toute raisonnable, que l’injustice. La liberté est donc naturelle ; c’est pourquoi, à mon avis, nous
ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre.
Et s’il s’en trouve par hasard qui en doutent encore — abâtardis au point de ne pas reconnaître
leurs dons ni leurs passions natives -, il faut que je leur fasse l’honneur qu’ils méritent et que je
hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chaire, pour leur enseigner leur nature et leur condition.
Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent bien les entendre, leur crient : « Vive la
liberté ! » Plusieurs d’entre elles meurent aussitôt prises. Tel le poisson qui perd la vie sitôt tiré de
l’eau, elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Si les animaux avaient
entre eux des prééminences, ils feraient de cette liberté leur noblesse. D’autres bêtes, des plus
grandes aux plus petites, lorsqu’on les prend, résistent si fort des ongles, des cornes, du bec et du
pied qu’elles démontrent assez quel prix elles accordent à ce qu’elles perdent. Une fois prises, elles
nous donnent tant de signes flagrants de la connaissance de leur malheur qu’il est beau de les voir
alors languir plutôt que vivre, et gémir sur leur bonheur perdu plutôt que de se plaire en servitude.
Que veut dire d’autre l’éléphant lorsque, s’étant défendu jusqu’au bout, sans plus d’espoir, sur le
point d’être pris, il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que son grand
désir de demeurer libre lui donne de l’esprit et l’avise de marchander avec les chasseurs : à voir s’il
pourra s’acquitter par le prix de ses dents et si son ivoire, laissé pour rançon, rachètera sa liberté ?
Nous flattons le cheval dès sa naissance pour l’habituer à servir. Nos caresses ne l’empêchent
pas de mordre son frein, de ruer sous l’éperon lorsqu’on veut le dompter. Il veut témoigner par là,
ce me semble, qu’il ne sert pas de son gré, mais bien sous notre contrainte. Que dire encore ?
« Même les boeufs, sous le joug, geignent, et les oiseaux, en cage, se plaignent. Je l’ai dit
autrefois en vers...
Ainsi donc, puisque tout être pourvu de sentiment sent le malheur de la sujétion et court après
la liberté ; puisque les bêtes, même faites au service de l’homme, ne peuvent s’y soumettre qu’après
avoir protesté d’un désir contraire, quelle malchance a pu dénaturer l’homme — seul vraiment né
pour vivre libre — au point de lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir de le
reprendre ?
Il y a trois sortes de tyrans.
Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par
succession de race. Ceux qui ont acquis le pouvoir par le droit de la guerre s’y comportent —
on le sait et le dit fort justement comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois, en général, ne
sont guère meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie, ils sucent avec le lait le naturel du
tyran et ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leurs serfs héréditaires. Selon leur
penchant dominant — avares ou prodigues —, ils usent du royaume comme de leur héritage. Quant
à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu’il devrait être plus supportable ; il le serait, je
crois, si dès qu’il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu’on appelle
grandeur, il décidait de n’en plus bouger. Il considère presque toujours la puissance que le peuple
lui a léguée comme devant être transmise à ses enfants. Or dès que ceux-ci ont adapté cette opinion,
il est étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices, et même en cruautés, tous
les autres tyrans. Ils ne trouvent pas meilleur moyen pour assurer leur nouvelle tyrannie que de
7
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
renforcer la servitude et d’écarter si bien les idées de liberté de l’esprit de leurs sujets que, pour
récent qu’en soit le souvenir, il s’efface bientôt de leur mémoire. Pour dire vrai, je vois bien entre
ces tyrans quelques différences, mais de choix, je n’en vois pas : car s’ils arrivent au trône par des
moyens divers, leur manière de règne est toujours à peu près la même. Ceux qui sont élus par le
peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme leur proie, les successeurs
comme un troupeau d’esclaves qui leur appartient par nature.
Je poserai cette question : si par hasard il naissait aujourd’hui quelques gens tout neufs, ni
accoutumés à la sujétion, ni affriandés à la liberté, ignorant jusqu’au nom de l’une et de l’autre,
et qu’on leur proposât d’être sujets ou de vivre libres, quel serait leur choix ? Sans aucun doute,
ils préféreraient de beaucoup obéir à la seule raison que de servir un homme, à moins qu’ils ne
soient comme ces gens d’Israël qui, sans besoin ni contrainte, se donnèrent un tyran. Je ne lis
jamais leur histoire sans en éprouver un dépit extrême qui me porterait presque à être inhumain,
jusqu’à me réjouir de tous les maux quu leur advinrent. Car pour que les hommes, tant qu’ils sont
des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l’une : ou qu’ils y soient contraints, ou
qu’ils soient trompés. Contraints par les armes étrangères comme le furent Sparte et Athènes par
celles d’Alexandre, ou trompés par les factions comme le fut le gouvernement d’Athènes, tombé
auparavant aux mains de Pisistrate. Ils perdent souvent leur liberté en étant trompés, mais sont
moins souvent séduits par autrui qu’ils ne se trompent eux-mêmes. Ainsi le peuple de Syracuse,
capitale de la Sicile, pressé par les guerres, ne songeant qu’au danger du moment, élut Denys
Premier et lui donna le commandement de l’armée. Il ne prit garde qu’il l’avait fait aussi puissant
que lorsque ce malin, rentrant victorieux comme s’il eût vaincu ses concitoyens plutôt que ses
ennemis, se fit d’abord capitaine, puis roi, et de roi tyran. Il est incroyable de voir comme le
peuple, dès qu’il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu’il lui est
impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait à le voir
qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa servitude.
Il est vrai qu’au commencement on sert contraint et vaincu par la force ; mais les successeurs
servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. Les hommes
nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de
vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d’autres biens ni d’autres droits que ceux qu’ils
ont trouvés ; ils prennent pour leur état de nature l’état de leur naissance.
Toutefois il n’est pas d’héritier, même prodigue ou nonchalant, qui ne porte un jour les yeux
sur les registres de son père pour voir s’il jouit de tous les droits de sa succession et si l’on n’a
rien entrepris contre lui ou contre son prédécesseur. Mais l’habitude, qui exerce en toutes choses
un si grand pouvoir sur nous, a surtout celui de nous apprendre à servir et, comme on le raconte
de Mithridate, qui finit par s’habituer au poison, celui de nous apprendre à avaler le venin de la
servitude sans le trouver amer. Nul doute que la nature nous dirige là où elle veut, bien ou mal lotis,
mais il faut avouer qu’elle a moins de pouvoir sur nous que l’habitude. Si bon que soit le naturel,
il se perd s’il n’est entretenu, et l’habitude nous forme toujours à sa manière, en dépit de la nature.
Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues, si frêles, qu’elles ne peuvent
résister au moindre choc d’une habitude contraire. Elles s’entretiennent moins facilement qu’elles
ne s’abâtardissent, et même dégénèrent, tels ces arbres fruitiers qui conservent les caractères de
leur espèce tant qu’on les laisse venir, mais qui les perdent pour porter des fruits différents des
leurs, selon la manière dont on les greffe.
Les herbes aussi ont chacune leur propriété, leur naturel, leur singularité ; pourtant la durée, les
8
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
intempéries, le sol ou la main du jardinier augmentent ou diminuent de beaucoup leurs vertus. La
plante qu’on a vue dans un pays n’est souvent plus reconnaissable dans un autre. Celui qui verrait
les Vénitiens, une poignée de gens vivant si librement que le plus misérable d’entre eux ne voudrait
pas être roi, nés et élevés de façon qu’ils ne connaissent d’autre ambition que celle d’entretenir
pour le mieux leur liberté, éduqués et formés dès le berceau de telle sorte qu’ils n’échangeraient
pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités de la terre... Celui, dis-je, qui verrait ces
personnes-là, et qui s’en irait ensuite sur le domaine de quelque « grand seigneur », y trouvant
des gens qui ne sont nés que pour le servir et qui abandonnent leur propre vie pour maintenir sa
puissance, penserait-il que ces deux peuples sont de même nature ? Ou ne croirait-il pas plutôt
qu’en sortant d’une cité d’hommes, il est entré dans un parc de bêtes ?
On raconte que Lycurgue, le législateur de Sparte, avait nourri deux chiens, tous deux frères,
tous deux allaités au même lait. L’un était engraissé à la cuisine, l’autre habitué à courir les champs
au son de la trompe et du cornet. Voulant montrer aux Lacédémoniens que les hommes sont tels
que la culture les a faits, il exposa les deux chiens sur la place publique et mit entre eux une soupe
et un lièvre. L’un courut au plat, l’autre au lièvre. Et pourtant, dit-il, ils sont frères !
Celui-là, avec ses lois et son art politique, éduqua et forma si bien les Lacédémoniens que
chacun d’eux préférait souffrir mille morts plutôt que de se soumettre à un autre maître que la loi
et la raison.
Je prends plaisir à rappeler ici une anecdote concernant l’un des favoris de Xerxès, grand roi de
Perse, et deux Spartiates. Lorsque Xerxès faisait ses préparatifs de guerre pour conquérir la Grèce
entière, il envoya ses ambassadeurs dans plusieurs villes de ce pays pour demander de l’eau et de la
terre — c’était la manière qu’avaient les Perses de sommer les villes de se rendre. Il se garda bien
d’en envoyer à Sparte ni à Athènes parce que les Spartiates et les Athéniens, auxquels son père
Darius en avait envoyés auparavant, les avaient jetés, les uns dans les fossés, les autres dans les
puits en leur disant : « Allez-y, prenez là de l’eau et de la terre, et portez-les à votre prince. » Ces
gens ne pouvaient souffrir que, même par la moindre parole, on attentât à leur liberté. Les Spartiates
reconnurent qu’en agissant de la sorte, ils avaient offensé les dieux, et surtout Talthybie, le dieu des
héraults. Ils résolurent donc, pour les apaiser d’envoyer à Xerxès deux de leurs concitoyens afin
que, disposant d’eux à son gré, il pût se venger sur eux du meurtre des ambassadeurs de son père.
Deux Spartiates, l’un nommé Sperthiès et l’autre Bulis, s’offrirent comme victimes volontaires.
Ils partirent. Arrivés au palais d’un Perse nommé Hydarnes, lieutenant du roi pour toutes
les villes d’Asie qui étaient sur les côtes de la mer, celui-ci les accueillit fort honorablement, leur
fit grande chère et, de fil en aiguille, leur demanda pourquoi ils rejetaient si fort l’amitié du roi. «
Spartiates, dit-il, voyez par mon exemple comment le Roi sait honorer ceux qui le méritent. Croyez
que si vous étiez à son service et qu’il vous eût connus, vous seriez tous les deux gouverneurs de
quelque ville grecque. » Les Lacédémoniens répondirent : « En ceci, Hydarnes, tu ne pourrais nous
donner un bon conseil ; car si tu as essayé le bonheur que tu nous promets, tu ignores entièrement
celui dont NOUS jouissons. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais tu ne sais pas quel goût délicieux
a la liberté. Or si tu en avais seulement goûté, tu nous conseillerais de la défendre, non seulement
avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et avec les ongles ». Seuls les Spartiates disaient
vrai, mais chacun parlait ici selon l’éducation qu’il avait reçue. Car il était aussi impossible au Persan
de regretter la liberté dont il n’avait jamais joui qu’aux Lacédémoniens, qui l’avaient savourée,
d’endurer l’esclavage.
Caton d’Utique, encore enfant et sous la férule de son maître, allait souvent voir le dictateur
9
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Sylla chez qui il avait ses entrées, tant à cause du rang de sa famille que de ses liens de parenté.
Dans ces visites, il était toujours accompagné de son précepteur, comme c’était l’usage à Rome
pour les enfants des nobles. Il vit un jour que dans l’hôtel même de Sylla, en sa présence ou par
son commandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres ; l’un était banni, l’autre
étranglé. L’un demandait la confiscation des biens d’un citoyen, l’autre sa tête. En somme, tout s’y
passait non comme chez un magistrat de la cité, mais comme chez un tyran du peuple ; c’était moins
le sanctuaire de la justice qu’une caverne de tyrannie. Ce jeune garcon dit à son précepteur : « Que
ne me donnez-vous un poignard ? Je le cacherai sous ma robe. J’entre souvent dans la chambre de
Sylla avant qu’il ne soit levé... J’ai le bras assez fort pour en libérer la ville. » Voilà vraiment la
parole d’un Caton. Ce début d’une vie était digne de sa mort. Taisez le nom et le pays, racontez
seulement le fait tel qu’il est : il parle de lui-même. On dira aussitôt : « Cet enfant était romain, né
dans Rome, lorsqu’elle était libre. » Pourquoi dis-je ceci ? Je ne prétends certes pas que le pays et
le sol n’y fassent rien, car partout et en tous lieux l’esclavage est amer aux hommes et la liberté leur
est chère. Mais il me semble qu’on doit avoir pitié de ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous
le joug, qu’on doit les excuser ou leur pardonner si, n’ayant pas même vu l’ombre de la liberté, et
n’en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d’être esclaves. S’il est des pays,
comme le dit Homère de celui des Cimériens, où le soleil se montre tout différent qu’à nous, où
après les avoir éclairés pendant six mois consécutifs, il les laisse dans l’obscurité durant les six
autres mois, faut-il s’étonner que ceux qui naissent pendant cette longue nuit, s’ils n’ont point ouï
parler de la clarté ni jamais vu le jour, s’accoutument aux ténèbres où ils sont nés sans désirer la
lumière ?
On ne regrette jamais ce qu’on n’a jamais-eu. Le chagrin ne vient qu’après le plaisir et toujours,
à la connaissance du malheur, se joint le souvenir de quelque joie passée. La nature de l’homme
est d’être libre et de vouloir l’être, mais il prend facilement un autre pli lorsque l’éducation le lui
donne.
Disons donc que, si toutes choses deviennent naturelles à l’homme lorsqu’il s’y habitue, seul
reste dans sa nature celui qui ne désire que les choses simples et non altérées. Ainsi la première
raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude. Voilà ce qui arrive aux plus braves chevaux qui
d’abord mordent leur frein, et après s’en jouent, qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent
maintenant d’eux-mêmes sous le harnais et, tout fiers, se rengorgent sous l’armure.
Ils disent qu’ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu’ils sont
tenus d’endurer le mal, s’en persuadent par des exemples et consolident eux-mémes, par la durée,
la possession de ceux qui les tyrannisent.
Mais en vérité les années ne donnent jamais le droit de mal faire. Elles accroissent l’injure. Il
s’en trouve toujours certains, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent
se retenir de le secouer, qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion et qui, comme Ulysse cherchait
par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison, n’ont garde d’oublier leurs droits naturels, leurs
origines, leur état premier, et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant
l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui
est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger
le présent et prévoir l’avenir. Ce sont eux qui, ayant d’eux-mêmes la tête-bien faite, l’ont encore
affinée par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce
monde, l’imaginent et la sentent en leur esprit, et la savourent. Et la servitude les dégoûte, pour si
bien qu’on l’accoutre.
10
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Le grand Turc s’est bien apercu que les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose
aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Je comprends que, dans son
pays, il n’a guère de savants, ni n’en demande. Le zèle et la passion de ceux qui sont restés,
malgré les circonstances, les dévots de la liberté, restent communément sans effet, quel que soit
leur nombre, parce qu’ils ne peuvent s’entendre. Les tyrans leur enlèvent toute liberté de faire, de
parler et presque de penser, et ils demeurent isolés dans leurs rêves. Momus ne plaisantait pas trop,
lorsqu’il trouvait à redire à l’homme forgé par Vulcain, en ce qu’il n’avait pas une petite fenêtre au
coeur, afin qu’on pût y voir ses pensées...
On dit que Brutus et Cassius, lorsqu’ils entreprirent de délivrer Rome (c’est-à-dire le monde
entier), ne voulurent point que Cicéron, ce grand zélateur du bien public, fût de la partie, jugeant
son coeur trop faible pour un si haut fait. Ils croyaient bien à son vouloir, mais non à son courage.
Qui voudra se rappeler les temps passés et compulser les annales anciennes se convaincra que
presque tous ceux qui, voyant leur pays malmené et en de mauvaises mains, formèrent le dessein
de le délivrer, dans une intention bonne, entière et droite, en vinrent facilement à bout ; pour se manifester
elle-même, la liberté vint toujours à leur aide. Harmodius, Aristogiton, Thrasybule, Brutus
l’Ancien, Valerius et Dion, qui conçurent un projet si vertueux, l’exécutèrent avec bonheur. En de
tels cas, le ferme vouloir garantit presque toujours le succès. Brutus le jeune et Cassius réussirent à
briser la servitude ; ils périrent lorsqu’ils tentèrent de ramener la liberté, non pas misérablement —
car qui oserait trouver rien de misérable ni dans leur vie ni dans leur mort ? - mais au grand dommage,
pour le malheur perpétuel et pour la ruine entière de la république, laquelle, ce me semble,
fut enterrée avec eux. Les autres tentatives essayées depuis contre les empereurs romains ne furent
que les conjurations de quelques ambitieux dont l’irréussite et la mauvaise fin ne sont pas à regretter,
vu qu’ils ne désiraient pas renverser le trône, mais seulement ébranler la couronne, cherchant à
chasser le tyran pour mieux garder la tyrannie. Quant à ceux-là, je serais bien fâché qu’ils eussent
réussi, et je suis content qu’ils aient montré par leur exemple qu’il ne faut pas abuser du saint nom
de la liberté pour conduire une mauvaise action.
Mais pour revenir à mon sujet, que j’avais presque perdu de vue, la première raison pour laquelle
les hommes servent volontairement, c’est qu’ils naissent serfs et qu’ils sont élevés comme
tels. De cette première raison découle cette autre : que, sous les tyrans, les gens deviennent aisément
lâches et efféminés. Je sais gré au grand Hippocrate, père de la médecine, de l’avoir si bien
remarqué dans son livre Des maladies. Cet homme avait bon coeur, et il le montra lorsque le roi de
Perse voulut l’attirer près de lui à force d’offres et de grands présents ; il lui répondit franchement
qu’il se ferait un cas de conscience de s’occuper à guérir les Barbares qui voulaient tuer les Grecs,
et à servir par son art celui qui voulait asservir son pays. La lettre qu’il lui écrivit se trouve encore
aujourd’hui dans ses autres oeuvres ; elle témoignera toujours de son courage et de sa noblesse.
Il est certain qu’avec la liberté on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n’ont ni ardeur
ni pugnacité au combat. Ils y vont comme ligotés et tout engourdis, s’acquittant avec peine d’une
obligation. Ils ne sentent pas bouillir dans leur coeur l’ardeur de la liberté qui fait mépriser le péril
et donne envie de gagner, par une belle mort auprès de ses compagnons, l’honneur et la gloire. Chez
les hommes libres au contraire, c’est à l’envi, à qui mieux mieux, chacun pour tous et chacun pour
soi : ils savent qu’ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais
les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité, ont le coeur bas et mou et sont incapables
de toute grande action. Les tyrans le savent bien. Aussi font-ils tout leur possible pour mieux les
avachir.
11
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
L’historien Xénophon, l’un des plus sérieux et des plus estimés parmi les Grecs, a fait un petit
livre dans lequel il fait dialoguer Simonide avec Hiéron, tyran de Syracuse, sur les misères du
tyran. Ce livre est plein de leçons bonnes et graves qui ont aussi, selon moi, une grâce infinie. Plut
à Dieu que tous les tyrans qui aient jamais été l’eussent placé devant eux en guise de miroir. Ils
y auraient certainement reconnu leurs verrues et en auraient pris honte de leurs taches. Ce traité
parle de la peine qu’éprouvent les tyrans qui, faisant du mal à tous, sont obligés de craindre tout
le monde. Il dit, entre autres choses, que les mauvais rois prennent à leur service des étrangers
mercenaires parce qu’ils n’osent plus donner les armes à leurs sujets, qu’ils ont maltraités. En
France même, plus encore autrefois qu’aujourd’hui, quelques bons rois ont bien eu à leur solde
des troupes étrangères, mais c’était plutôt pour sauvegarder leurs propres sujets ; ils ne regardaient
pas à la dépense pour épargner les hommes. C’était aussi, je crois, l’opinion du grand Scipion
l’Africain, qui aimait mieux avoir sauvé la vie d’un citoyen que d’avoir défait cent ennemis. Mais
ce qui est certain, c’est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée s’il n’est pas parvenu au
point de n’avoir pour sujets que des hommes sans valeur. On pourrait lui dire à juste titre ce que,
d’après Térence,Thrason disait au maître des éléphants : r
« Si brave donc vous êtes,
Que vous avez charge des bêtes ? »
Cette ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets n’a jamais été plus évidente que dans la conduite
de Cyrus envers les Lydiens, après qu’il se fut emparé de leur capitale et qu’il eut pris pour captif
Crésus, ce roi si riche. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s’étaient révoltés.
Il les eut bientôt réduits à l’obéissance. Mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville ni être
obligé d’y tenir une armée pour la maîtriser, il s’avisa d’un expédient admirable pour s’en assurer
la possession. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et publia une ordonnance
qui obligeait les citoyens à s’y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que, par la suite, il n’eut
plus à tirer l’épée contre les Lydiens. Ces misérables s’amusèrent à inventer toutes sortes de jeux
si bien que, de leur nom même, les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous
appelons passe-temps, qu’ils nommaient Ludi, par corruption de Lydi.
Tous les tyrans n’ont pas déclaré aussi expressément vouloir efféminer leurs sujets ; mais de
fait, ce que celui-là ordonna formellement, la plupart d’entre eux l’ont fait en cachette. Tel est le
penchant naturel du peuple ignorant qui, d’ordinaire, est plus nombreux dans les villes : il est soupçonneux
envers celui qui l’aime et confiant envers celui qui le trompe. Ne croyez pas qu’il y ait nul
oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plus
tôt à l’hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude, pour la
moindre douceur qu’on leur fait goûter. C’est chose merveilleuse qu’ils se laissent aller si promptement,
pour peu qu’on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs,
les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les
peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie.
Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu’employaient les anciens tyrans pour
endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps,
amusés d’un vain plaisir qui les éblouissait, s’habituaient à servir aussi niaisement mais plus mal
que les petits enfants n’apprennent à lire avec des images brillantes.
Les tyrans romains renchérirent encore sur ces moyens en faisant souvent festoyer les décuries,
en gorgeant comme il le fallait cette canaille qui se laisse aller plus qu’à toute autre chose au
plaisir de la bouche. Ainsi, le plus éveillé d’entre eux n’aurait pas quitté son écuelle de soupe pour
12
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
recouvrer la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient largesse du quart de blé, du
septier de vin, du sesterce, et c’était pitié alors d’entendre crier : « Vive le roi ! » Ces lourdeaux
ne s’avisaient pas qu’ils ne faisaient que recouvrer une part de leur bien, et que cette part même
qu’ils en recouvraient, le tyran n’aurait pu la leur donner si, auparavant, il ne la leur avait enlevée.
Tel ramassait aujourd’hui le sesterce, tel se gorgeait au festin public en bénissant Tibère et Néron
de leur libéralité qui, le lendemain, contraint d’abandonner ses biens à l’avidité, ses enfants à la
luxure, son sang même à la cruauté de ces empereurs magnifiques, ne disait mot, pas plus qu’une
pierre, et ne se remuait pas plus qu’une souche. Le peuple ignorant a toujours été ainsi : au plaisir
qu’il ne peut honnêtement recevoir, il est tout dispos et dissolu ; au tort et à la douleur qu’il peut
honnêtement soufflir, il est insensible.
Je ne vois personne aujourd’hui qui, entendant parler de Néron, ne tremble au seul nom de ce
vilain monstre, de cette sale peste du monde. Il faut pourtant dire qu’après la mort, aussi dégoûtante
que sa vie, de ce bouteleu, de ce bourreau, de cette bête sauvage, ce fameux peuple romain en
éprouva tant de déplaisir, se rappelant ses jeux et ses festins, qu’il fut sur le point d’en porter le
deuil. C’est du moins ce qu’en écrit Tacite, excellent auteur, historien des plus fiables. Et l’on ne
trouvera pas cela étrange si l’on considère ce que ce même peuple avait déjà fait à la mort de Jules
César, qui avait donné congé aux lois et à la liberté romaine. On louait surtout, ce me semble, dans
ce personnage, son « humanité » ; or, elle fut plus funeste à son pays que la plus grande cruauté du
plus sauvage tyran qui ait jamais vécu, car à la vérité ce fut cette venimeuse douceur qui emmiella
pour le peuple romain le breuvage de la servitude. Après sa mort ce peuple-là, qui avait encore à
la bouche le goût de ses banquets et à l’esprit la mémoire de ses prodigalités, amoncela les bancs
de la place publique pour lui en faire un grand bûcher d’honneur ; puis il lui éleva une colonne
comme au Père du peuple (le chapiteau portait cette inscription) ; enfin il fit plus d’honneurs à ce
mort qu’il n’aurait dû en faire à un vivant, et d’abord à ceux qui l’avaient tué.
Les empereurs romains n’oubliaient surtout pas de prendre le titre de Tribun du peuple, parce
que cet office était tenu pour saint et sacré ; établi pour la défense et la protection du peuple,
il jouissait d’une haute faveur dans l’État. Ils s’assuraient par ce moyen que le peuple se fierait
mieux à eux, comme s’il lui suffisait d’entendre ce nom, sans avoir besoin d’en sentir les effets.
Mais ils ne font guère mieux ceux d’aujourd’hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus
graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement
des malheureux. On connaît la formule dont ils font si finement usage ; mais peut-on parler de
finesse là où il y a tant d’impudence ?
Les rois d’Assyrie, et après eux les rois Mèdes, paraissaient en public le plus rarement possible,
pour faire supposer au peuple qu’il y avait en eux quelque chose de surhumain et laisser rêver ceux
qui se montent l’imagination sur les choses qu’ils ne peuvent voir de leurs propres yeux. Ainsi
tant de nations qui furent longtemps sous l’empire de ces rois mystérieux s’habituèrent à les servir,
et les servirent d’autant plus volontiers qu’ils ignoraient qui était leur maître, ou même s’ils en
avaient un ; de telle sorte qu’ils vivaient dans la crainte d’un être que personne n’avait jamais vu.
Les premiers rois d’Egypte ne se montraient guère sans porter tantôt une branche, tantôt du feu
sur la tête : ils se masquaient et jouaient aux bateleurs, inspirant par ces formes étranges respect
et admiration à leurs sujets qui, s’ils n’avaient pas été aussi stupides ou soumis, auraient dû s’en
moquer et en rire. C’est vraiment lamentable de découvrir tout ce que faisaient les tyrans du temps
passé pour fonder leur tyrannie, de voir de quels petits moyens ils se servaient, trouvant toujours
la populace si bien disposée à leur égard qu’ils n’avaient qu’à tendre un filet pour la prendre ; ils
13
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
n’ont jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l’ont jamais mieux asservie que lorsqu’ils s’en
moquaient le plus.
Que dirai-je d’une autre sornette que les peuples anciens prirent pour argent comptant ? Ils
crurent fermement que l’orteil de Pyrrhus, roi d’Épire, faisait des miracles et guérissait les malades
de la rate. Ils enjolivèrent encore ce conte en disant que, lorsqu’on eut brûlé le cadavre de
ce roi, l’orteil se retrouva dans les cendres épargné du feu, intact. Le peuple a toujours ainsi fabriqué
lui-même les mensonges, pour y ajouter ensuite une foi stupide. Bon nombres d’auteurs ont
rapporté ces mensonges ; on voit aisément qu’ils les ont ramassés dans les ragots des villes et les
fables des ignorants. Telles sont les merveilles que fit Vespasien, revenant d’Assyrie et passant par
Alexandrie pour aller à Rome s’emparer de l’Empire : il redressait les boiteux, rendait clairvoyants
les aveugles, et mille autres choses qui ne pouvaient être crues, à mon avis, que par de plus aveugles
que ceux qu’il guérissait.
Les tyrans eux-mêmes trouvaient étrange que les hommes souffrissent qu’un autre les maltraitât,
c’est pourquoi ils se couvraient volontiers du manteau de la religion et s’affublaient autant que
faire se peut des oripeaux de la divinité pour cautionner leur méchante vie. Ainsi Salmonée, pour
s’être moqué du peuple en faisant son Jupiter, se trouve maintenant au fin fond de l’enfer, selon là
sibylle de Virgile, qui l’y a vu :
« Là, des fils d’Aloüs gisent les corps énormes,
Ceux qui, fendant les airs de leurs têtes difformes
Osérent attenter aux demeures des Dieux,
Et du trône éternel chasser le Roi des cieux.
Là, j’ai vu de ces dieux le rival sacrilège,
Qui du foudre usurpant le divin privilège
Pour arracher au peuple un criminel encens
De quatre fiers coursiers aux pieds retentissants
Attelant un vain char dans l’Élide tremblante
Une torche à h main y semait l’épouvante :
Insensé qui, du ciel prétendu souverain,
Par le bruit de son char et de son pont d’airain
Du tonnerre imitait le bruit inimitable !
Mais Jupiter lança le foudre véritable
Et renversa, couvert d’un tourbillon de feu,
Le char et les coursiers et la foudre et le Dieu :
Son triomphe fut court, sa peine est éternelle. »
Si celui qui voulut simplement faire l’idiot se trouve là-bas si bien traité, je pense que ceux qui
ont abusé de la religion pour mal faire s’y trouveront encore à meilleure enseigne.
Nos tyrans de France ont semé aussi je ne sais quoi du genre : des crapauds, des fleurs de lys,
la Sainte Ampoule et l’oriflamme. Toutes choses que, pour ma part et quoi qu’il en soit, je ne veux
pas croire n’être que des balivernes, puisque nos ancêtres les croyaient et que de notre temps nous
n’avons eu aucune occasion de les soupçonner telles. Car nous avons eu quelques rois si bons à
la paix, si vaillants à la guerre que, bien qu’ils fussent nés rois, il semble que la nature ne les ait
pas faits comme les autres et que le dieu tout-puissant les ait choisis avant leur naissance pour leur
confier le gouvernement et la garde de ce royaume. Et quand cela ne serait pas, je ne voudrais
14
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires, ni les éplucher trop librement pour
ne pas ravir ce beau thème où pourra si bien s’escrimer notre poésie française, cette poésie non
seulement agrémentée, mais pour, ainsi dire refaite à neuf par nos Ronsard, Baïf et du Bellay : ils
font tellement progresser notre langue que bientôt, j’ose l’espérer, nous n’aurons rien à envier aux
Grecs ni aux Latins, hormis le droit d’aînesse.
Certes, je ferais grand tort à notre rime (j’use volontiers de ce mot qui me plaît, car bien
que plusieurs l’aient rendue purement mécanique, j’en vois toutefois assez d’autres capables de
l’anoblir et de lui rendre son premier lustre). Je lui ferais, dis-je, grand tort en lui ravissant ces jolis
contes du roi Clavis, dans lesquels s’égaiera si plaisamment, si aisément, la verve de notre Ronsard,
dans sa Franciade. Je saisis sa portée, je connais son esprit fin et je sais la grâce de l’homme. Il fera
son affaire de l’oriflamme, aussi bien que les Romains le faisaient de leurs ancilles et de ces
« boucliers du ciel en bas jetés »,
dont parle Virgile. Il tirera de notre Sainte Ampoule un parti aussi bon que les Athéniens en
tirérent de leur corbeille d’Erisicthone. Il parlera de nos armoiries aussi bien qu’eux de leur olivier,
qu’ils prétendent exister encore dans la tour de Minerve. Certes, je serais téméraire de vouloir
démentir nos livres et de courir ainsi sur les terres de nos poètes.
Mais pour revenir à mon sujet, dont je me suis éloigné je ne sais trop comment, n’est-il pas clair
que les tyrans, pour s’affermir, se sont efforcés d’habituer le peuple, non seulement à l’obéissance
et à la servitude mais encore à leur dévotion ? Tout ce que j’ai dit jusqu’ici des moyens employés
par les tyrans pour asservir n’est exercé que sur le petit peuple ignorant.
J’en arrive maintenant à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination,
le soutien et le fondement de toute tyrannie. Celui qui penserait que les hallebardes, les gardes
et le guet garantissent les tyrans, se tromperait fort. Ils s’en servent, je crois, par forme et pour
épouvantail, plus qu’ils ne s’y fient. Les archers barrent l’entrée des palais aux malhabiles qui n’ont
aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. On voit aisément que, parmi les empereurs
romains, moins nombreux sont ceux qui échappèrent au danger grâce au secours de leurs archers
qu’il n’y en eut de tués par ces archers mêmes. Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, les
compagnies de fantassins, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais toujours (on aura
peine à le croire d’abord, quoique ce soit l’exacte vérité) quatre ou cinq hommes qui le soutiennent
et qui lui soumettent tout le pays. Il en a toujours été ainsi : cinq ou six ont eu l’oreille du tyran
et s’en sont approchés d’eux-mêmes, ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de
ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et les bénéficiaires
de ses rapines. Ces six dressent si bien leur chef qu’il en devient méchant envers la société, non
seulement de sa propre méchanceté mais encore des leurs. Ces six en ont sous eux six cents, qu’ils
corrompent autant qu’ils ont corrompu le tyran. Ces six cents en tiennent sous leur dépendance six
mille, qu’ils élèvent en dignité. Ils leur font donner le gouvernement des provinces ou le maniement
des deniers afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté, afin qu’ils les exercent à point
nommé et fassent d’ailleurs tant de mal qu’ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre, qu’ils
ne puissent s’exempter des lois et des peines que grâce à leur protection. Grande est la série de
ceux qui les suivent. Et qui voudra en dévider le fil verra que, non pas six mille, mais cent mille
et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui,
comme Homère le fait dire à Jupiter qui se targue, en tirant une telle chaîne, d’amener à lui tous
les dieux. De là venait l’accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César, l’établissement de
nouvelles fonctions, l’institution de nouveaux offices, non certes pour réorganiser la justice, mais
15
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, par les gains et les faveurs qu’on
reçoit des tyrans, on en arrive à ce point qu’ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels
la tyrannie profite, que ceux auxquels la liberté plairait.
Au dire des médecins, bien que rien ne paraisse changé dans-notre corps, dès que quelque
tumeur se manifeste en un seul endroit, toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse. De
même, dès qu’un roi s’est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un
tas de petits friponneaux et de faquins qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays, mais ceux
qui sont possédés d’une ambition ardente et d’une avidité notable se groupent autour de lui et le
soutiennent pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux.
Tels sont les grands voleurs et les fameux corsaires ; les uns courent le pays, les autres pourchassent
les voyageurs ; les uns sont en embuscade, les autres au guet ; les uns massacrent, les
autres dépouillent, et bien qu’il y ait entre eux des prééminences, que les uns ne soient que des
valets et les autres des chefs de bande, à la fin il n’y en a pas un qui ne profite, sinon du butin
principal, du moins de ses restes. On dit que les pirates ciliciens se rassemblèrent en un si grand
nombre qu’il fallut envoyer contre eux le grand Pompée, et qu’ils attirèrent à leur alliance plusieurs
belles et grandes villes dans les havres desquelles, en revenant de leurs courses, ils se mettaient en
sûreté, leur donnant en échange une part des pillages qu’elles avaient recélés.
C’est ainsi que le tyran asservit les sujets les uns par les autres. Il est gardé par ceux dont il
devrait se garder, s’ils valaient quelque chose. Mais on l’a fort bien dit : pour fendre le bois, on se
fait des coins du bois même ; tels sont ses archers, ses gardes, ses hallebardiers. Non que ceux-ci
n’en souffrent souvent eux-mêmes ; mais ces misérables abandonnés de Dieu et des hommes se
contentent d’endurer le mal et d’en faire, non à celui qui leur en fait, mais bien à ceux qui, comme
eux, l’endurent et n’y peuvent mais. Quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter
sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté
qu’apitoyé de leur sottise.
Car à vrai dire, s’approcher du tyran, est-ce autre chose que s’éloigner de sa liberté et, pour
ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude ? Qu’ils mettent un moment à part leur
ambition, qu’ils se dégagent un peu de leur avidité, et puis qu’ils se regardent ; qu’ils se considèrent
eux-mêmes : ils verront clairement que ces villageois, ces paysans qu’ils foulent aux pieds et qu’ils
traitent comme des forcats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, si malmenés, sont plus
heureux qu’eux et en quelque sorte plus libres. Le laboureur et l’artisan, pour asservis qu’ils soient,
en sont quittes en obéissant ; mais le tyran voit ceux qui l’entourent coquinant et mendiant sa faveur.
Il ne faut pas seulement qu’ils fassent ce qu’il ordonne, mais aussi qu’ils pensent ce qu’il veut et
souvent même, pour le satisfaire, qu’ils préviennent ses propres désirs. Ce n’est pas le tout de lui
obéir, il faut encore lu complaire ; il faut qu’ils se rompent, se tourmentent, se tuent à traiter ses
affaires, et puisqu’ils ne se plaisent qu’à son plaisir, qu’ils sacrifient leur goût au sien, qu’ils forcent
leur tempérament et dépouillent leur naturel. Il faut qu’ils soient attentifs à ses paroles, à sa voix, à
ses regards, à ses gestes : que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés
à épier ses volontés et à deviner ses pensées.
Est-ce là vivre heureux ? Est-ce même vivre ? Est-il rien au monde de plus insupportable que
cet état, je ne dis pas pour tout homme de coeur, mais encore pour celui qui n’a que le simple
bon sens, ou même figure d’homme ? Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi,
n’ayant rien à soi et tenant d’un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie ?
16
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Mais ils veulent servir pour amasser des biens : comme s’ils pouvaient rien gagner qui fût à
eux, puisqu’ils ne peuvent même pas dire qu’ils sont à eux-mêmes. Et comme si quelqu’un pouvait
avoir quelque chose à soi sous un tyran, ils veulent se rendre possesseurs de biens, oubliant que
ce sont eux qui lui donnent la force de ravir tout à tous, et de ne rien laisser qu’on puisse dire
être à sa personne. Ils voient pourtant que ce sont les biens qui rendent les hommes dépendants de
sa cruauté ; qu’il n’y a aucun crime plus digne de mort, selon lui, que l’avantage d’autrui ; qu’il
n’aime que les richesses et ne s’attaque qu’aux riches ; ceux-là viennent cependant se présenter à
lui comme des moutons devant le boucher, pleins et bien repus comme pour lui faire envie.
Ces favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que
de ceux qui, s’étant gorgés quelque temps, y ont perdu peu après les biens et la vie. Ils devraient
moins songer au grand nombre de ceux qui y ont acquis des richesses qu’au petit nombre de
ceux qui les ont conservées. Qu’on parcoure toutes les histoires anciennes et qu’on rappelle toutes
celles dont nous nous souvenons, on verra combien nombreux sont ceux qui, arrivés par de mauvais
moyens jusqu’à l’oreille des princes, soit en flattant leurs mauvais penchants, soit en abusant de
leur naïveté, ont fini par être écrasés par ces mêmes princes, qui avaient mis autant de facilité à
les élever que d’inconstance à les défendre. Parmi le grand nombre de ceux qui se sont trouvés
auprès des mauvais rois, il en est peu ou presque pas qui n’aient éprouvé eux-mêmes la cruauté du
tyran, qu’ils avaient auparavant attisée contre d’autres. Souvent enrichis à l’ombre de sa faveur des
dépouilles d’autrui, ils l’ont à la fin enrichi eux-mêmes de leur propre dépouille.
Et même les gens de bien — il arrive parfois que le tyran les aime —, si avancés qu’ils soient
dans sa bonne grâce, si brillantes que soient en eux la vertu et l’intégrité (qui, même aux méchants,
inspirent quelque respect lorsqu’on les voit de près) ; ces gens de bien, dis-je, ne sauraient se
maintenir auprès du tyran ; il faut qu’ils se ressentent aussi du mal commun et qu’ils éprouvent la
tyrannie à leurs dépens. Tel un Sénèque, un Burrhus, un Trazéas : cette trinité de gens de bien dont
les deux premiers eurent le malheur de s’approcher d’un tyran qui leur confia le maniement de ses
affaires, tous deux chéris de lui, et bien que l’un d’eux l’eût élevé, ayant pour gage de son amitié
les soins qu’il avait donnés à son enfance, ces trois-là, dont la mort fut si cruelle, ne sont-ils pas des
exemples suffisants du peu de confiance que l’on doit avoir dans la faveur d’un méchant maître ?
En vérité, quelle amitié attendre de celui qui a le coeur assez dur pour haïr tout un royaume qui
ne fait que lui obéir, et d’un être qui, ne sachant aimer, s’appauvrit lui-même et détruit son propre
empire ?
Or si l’on veut dire que Sénèque, Burrhus et Traséas n’ont éprouvé ce malheur que pour avoir
été trop gens de bien, qu’on cherche attentivement autour de Néron lui-même : on verra que tous
ceux qui furent en grâce auprès de lui et qui s’y maintinrent par leur méchanceté n’eurent pas
une fin meilleure. Qui a jamais entendu parler d’un amour aussi effréné, d’une affection aussi
opiniâtre, qui a jamais vu d’homme aussi obstinément attaché à une femme que celui-là le fut à
Poppée ? Or il l’empoisonna lui-même. Sa mère, Agrippine, pour le placer sur le trône, avait tué
son propre mari Claude ; elle avait tout entrepris et tout souffert pour le favoriser. Et cependant
son fils, son nourrisson, celui-là qu’elle avait fait empereur de sa propre main, lui ôta la vie après
l’avoir souvent maltraitée. Personne ne nia qu’elle n’eût bien mérité cette punition, si elle avait été
infligée par n’importe qui d’autre.
Qui fut jamais plus facile à manier, plus simple et, pour mieux dire, plus niais que l’empereur
Claude ? Qui fut jamais plus coiffé d’une femme que lui de Messaline ? Il la livra pourtant au
bourreau. Les tyrans bêtes restent bêtes au point de ne jamais savoir faire le bien, mais je ne sais
17
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
comment, à la fin, le peu qu’ils ont d’esprit se réveille en eux pour user de cruauté même envers
leurs proches. On connaît assez le mot de celui-là qui, voyant découverte la gorge de sa femme, de
celle qu’il aimait le plus, sans laquelle il semblait qu’il ne pût vivre, lui adressa ce joli compliment :
« Ce beau cotu sera coupé tout à l’heure, si je l’ordonne. » Voilà pourquoi la plupart des anciens
tyrans ont presque tous été tués par leurs favoris : connaissant la nature de la tyrannie, ceux-ci
n’étaient guère rassurés sur la volonté du tyran et se défiaient de sa puissance. C’est ainsi que
Domitien fut tué par Stéphanus, Commode par une de ses maîtresses, Caracalla par le centurion
Martial excité par Macrin, et de même presque tous les autres.
Certainement le tyran n’aime jamais, et n’est jamais aimé. L’amitié est un nom sacré, une chose
sainte. Elle n’existe qu’entre gens de bien. Elle naît d’une mutuelle estime et s’entretient moins par
les bienfaits que par l’honnêteté. Ce qui rend un ami sûr de l’autre, c’est la connaissance de son
intégrité. Il en a pour garants son bon naturel, sa fidélité, sa constance. Il ne peut y avoir d’amitié
là où se trouvent la cruauté, la déloyauté, l’injustice. Entre méchants, lorsqu’ils s’assemblent, c’est
un complot et non une société. Ils ne s’aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais
complices.
Quand bien même cela ne serait pas, il serait difficile de trouver chez un tyran un amour sûr,
parce qu’étant au-dessus de tous et n’ayant pas de pairs, il est déjà au-delà des bornes de l’amitié.
Celle-ci fleurit dans l’égalité, dont la marche est toujours égale et ne peut jamais clocher. Voilà
pourquoi il y a bien, comme on le dit, une espèce de bonne foi parmi les voleurs lors du partage
du butin, parce qu’alors ils y sont tous pairs et compagnons. S’ils ne s’aiment pas, du moins se
craignent-ils. Ils ne veulent pas amoindrir leur force en se désunissant.
Mais les favoris d’un tyran ne peuvent jamais compter sur lui parce qu’ils lui ont eux-mêmes
appris qu’il peut tout, qu’aucun droit ni devoir ne l’oblige, qu’il est habitué à n’avoir pour raison
que sa volonté, qu’il n’a pas d’égal et qu’il est le maître de tous. N’est-il pas déplorable que, malgré
tant d’exemples éclatants, sachant le danger si présent, personne ne veuille tirer leçon des misères
d’autrui et que tant de gens s’approchent encore si volontiers des tyrans ? Qu’il ne s’en trouve pas
un pour avoir la prudence et le courage de leur dire, comme le renard de la fable au lion qui faisait
le malade : « J’irais volontiers te rendre visite dans ta tanière ; mais je vois assez de traces de bêtes
qui y entrent ; quant à celles qui en sortent, je n’en vois aucune. »
Ces misérables voient reluire les trésors du tyran ; ils admirent, tout ébahis, les éclats de sa
magnificence ; alléchés par cette lueur, ils s’approchent sans s’apercevoir qu’ils se jettent dans une
flaimne qui ne peut manquer de les dévorer. Ainsi le satyre imprudent de la fable, voyant briller
le feu ravi par Prométhée, le trouva si beau qu’il alla le baiser et s’y brûla. Ainsi le papillon qui,
espérant jouir de quelque plaisir, se jette au feu parce qu’il le voit briller, éprouve bientôt, comme
dit Lucain, qu’il a aussi le pouvoir de brûler.
Mais supposons encore que ces mignons échappent aux mains de celui qu’ils servent, ils ne se
sauvent jamais de celles du roi qui lui succède. S’il est bon, il leur faut alors rendre des comptes
et se soumettre à la raison ; s’il est mauvais comme leur ancien maître, il ne peut manquer d’avoir
aussi ses favoris qui, d’ordinaire, non contents de prendre leur place, leur arrachent aussi le plus
souvent leurs biens et leur vie. Se peut-il donc qu’il se trouve quelqu’un qui, face à un tel péril
et avec si peu de garanties, veuille prendre une position si malheureuse et servir avec tant de
souffrances un maître aussi dangereux ?
Quelle peine, quel martyre, grand Dieu ! Être occupé nuit et jour à plaire à un homme, et
18
D ISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
se méfier de lui plus que de tout autre au monde. Avoir toujours l’oeil aux aguets, l’oreille aux
écoutes, pour épier d’où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour tâter la mine de ses
concurrents, pour deviner le traître. Sourire à chacun et se méfier de tous, n’avoir ni ennemi ouvert
ni ami assuré, montrer toujours un visage riant quand le coeur est transi ; ne pas pouvoir être joyeux,
ni oser être triste !
Il est vraiment plaisant de considérer ce qui leur revient de ce grand tourment, et de voir le bien
qu’ils peuvent attendre de leur peine et de leur vie misérable : ce n’est pas le tyran que le peuple
accuse du mal qu’il souffre, mais bien ceux qui le gouvernent.
Ceux-là, les peuples, les nations, tous à l’envi jusqu’aux paysans, jusqu’aux laboureurs, connaissent
leurs noms, décomptent leurs vices ; ils amassent sur eux mille outrages, mille insultes, mille jurons.
Toutes les prières, toutes les malédictions sont contre eux. Tous les malheurs, toutes les
pestes, toutes les famines leur sont comptées ; et si l’on fait parfois semblant de leur rendre hommage,
dans le même temps on les maudit du fond du coeur et on les tient plus en horreur que des
bêtes sauvages. Voilà la gloire, voilà l’honneur qu’ils recueillent de leurs services auprès des gens
qui, s’ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps, ne s’estimeraient pas encore satisfaits,
ni même à demi consolés de leur souffrance. Même après leur mort, leurs survivants n’ont de cesse
que le nom de ces mange-peuples ne soit noirci de l’encre de mille plumes, et leur réputation déchirée
dans mille livres. Même leurs os sont, pour ainsi dire, traînés dans la boue par la postérité,
comme pour les punir encore aprés leur mort de leur méchante vie.
Apprenons donc ; apprenons à bien faire. Levons les yeux vers le ciel pour notre honneur ou
pour l’amour de la vertu, mieux encore pour ceux du Dieu tout-puissant, fidèle témoin de nos actes
et juge de nos fautes. Pour moi, je pense — et ne crois pas me tromper-, puisque rien n’est plus
contraire à un Dieu bon et libéral que la tyrannie, qu’il réserve là-bas tout exprès, pour les tyrans
et leurs complices, quelque peine particulière.
19
Inscription à :
Articles (Atom)








